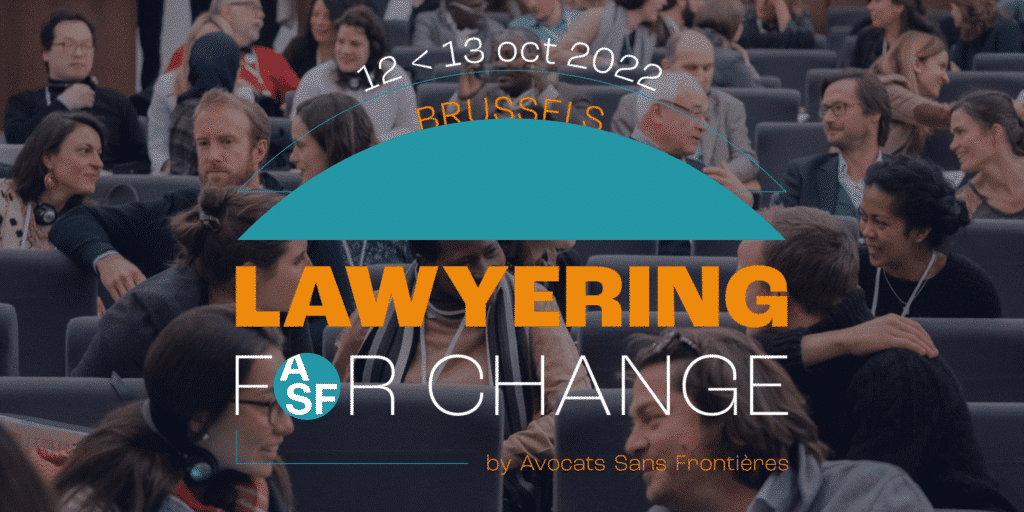
Inscriptions Plus d’informations
Les inscriptions pour la conférence internationale Lawyering for Change 2022 sont ouvertes !
L’événement, organisé par Avocats Sans Frontières, se tiendra les 12 et 13 octobre à l’Auditorium international à Bruxelles
Nous sommes ravi.e.s de vous annoncer officiellement la tenue de la conférence internationale Lawyering for Change les 12 et 13 octobre 2022 à Bruxelles.
Lawyering for Change 2022 réunira plus d’une trentaine d’intervenant.e.s, de différents pays et de spécialités multiples, qui partageront leurs expertises et surtout leurs expériences de terrain afin d’apporter une pluralité d’éclairages sur les défis qui se posent aujourd’hui pour la réalisation de l’accès à la justice et de l’Etat de droit.
L’accent sera mis plus particulièrement sur l’importance, face aux défis contemporains, de penser les actions par la coopération, de développer des coalitions entre cette multiplicité d’acteur.rice.s, de créer des réseaux et des communautés de partage de savoir et de collaboration.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
Nous espérons vous y croiser !
