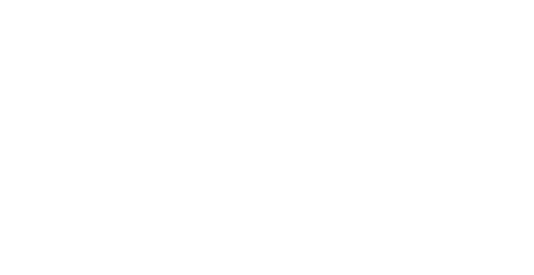Le 11 mars 2025, la Commission européenne a présenté une proposition de nouveau Règlement sur le retour, destinée à remplacer la Directive actuellement en vigueur.
Derrière ce titre technocratique, la proposition marque un tournant profond et inquiétant dans la politique migratoire de l’Union européenne : elle privilégie la déportation, la détention et la surveillance au détriment de la protection, de la dignité et des droits fondamentaux.
Avocats Sans Frontières (ASF) s’est joint à plus de 250 organisations de la société civile pour signer une déclaration conjointe demandant le retrait de cette proposition et appelant le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à la rejeter.
Un règlement fondé sur la contrainte et l’exclusion
Le projet de « Règlement sur les déportations » renforcerait les pouvoirs des États pour détenir, surveiller et expulser des personnes, y compris vers des pays avec lesquels elles n’ont aucun lien préalable. Il introduit des mesures qui feraient de la détention la norme, allongeraient sa durée maximale et permettraient même la création de centres de détention offshore, situés en dehors du territoire de l’UE.
La proposition impose également aux États de nouvelles obligations visant à « détecter » les personnes en situation irrégulière, ouvrant la voie à une augmentation du profilage racial, du partage de données et de la surveillance des communautés migrantes.
Dans le même temps, elle supprime des droits d’appel essentiels et des garanties procédurales, compromettant ainsi l’accès à la justice et le droit à un recours effectif.
Un tournant plus large dans la politique migratoire européenne
Cette proposition s’inscrit dans une tendance plus large et préoccupante de la gouvernance migratoire de l’UE : présenter la mobilité humaine comme une menace, plutôt que comme une réalité sociale à aborder avec humanité et respect des droits humains.
Plutôt que de s’attaquer aux causes structurelles des migrations ou de promouvoir des politiques d’inclusion, l’Union européenne investit dans des mécanismes punitifs de contrôle – détention, expulsion, externalisation – qui déshumanisent les personnes migrantes et affaiblissent les droits fondamentaux.
La position d’ASF
ASF s’oppose fermement à la criminalisation des migrations et à l’affaiblissement systématique des standards en matière de droits humains en Europe.
Nous défendons une politique migratoire fondée sur la protection, la solidarité et l’inclusion, et non sur la répression.
Comme le souligne la déclaration conjointe, toute réforme dans ce domaine doit s’appuyer sur une évaluation de l’impact sur les droits humains, une élaboration de politiques fondée sur des données probantes et une concertation significative avec la société civile.
Le projet de Règlement échoue sur l’ensemble de ces points.
Lire et soutenir la déclaration conjointe
La déclaration conjointe complète, signée par plus de 250 organisations à travers l’Europe, détaille les atteintes aux droits et les risques systémiques que comporte cette proposition.