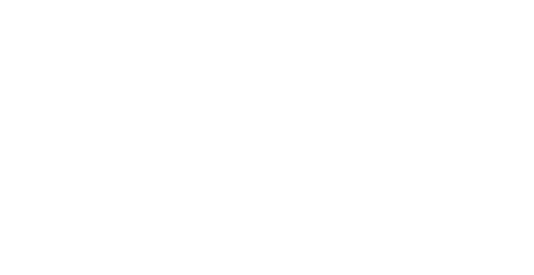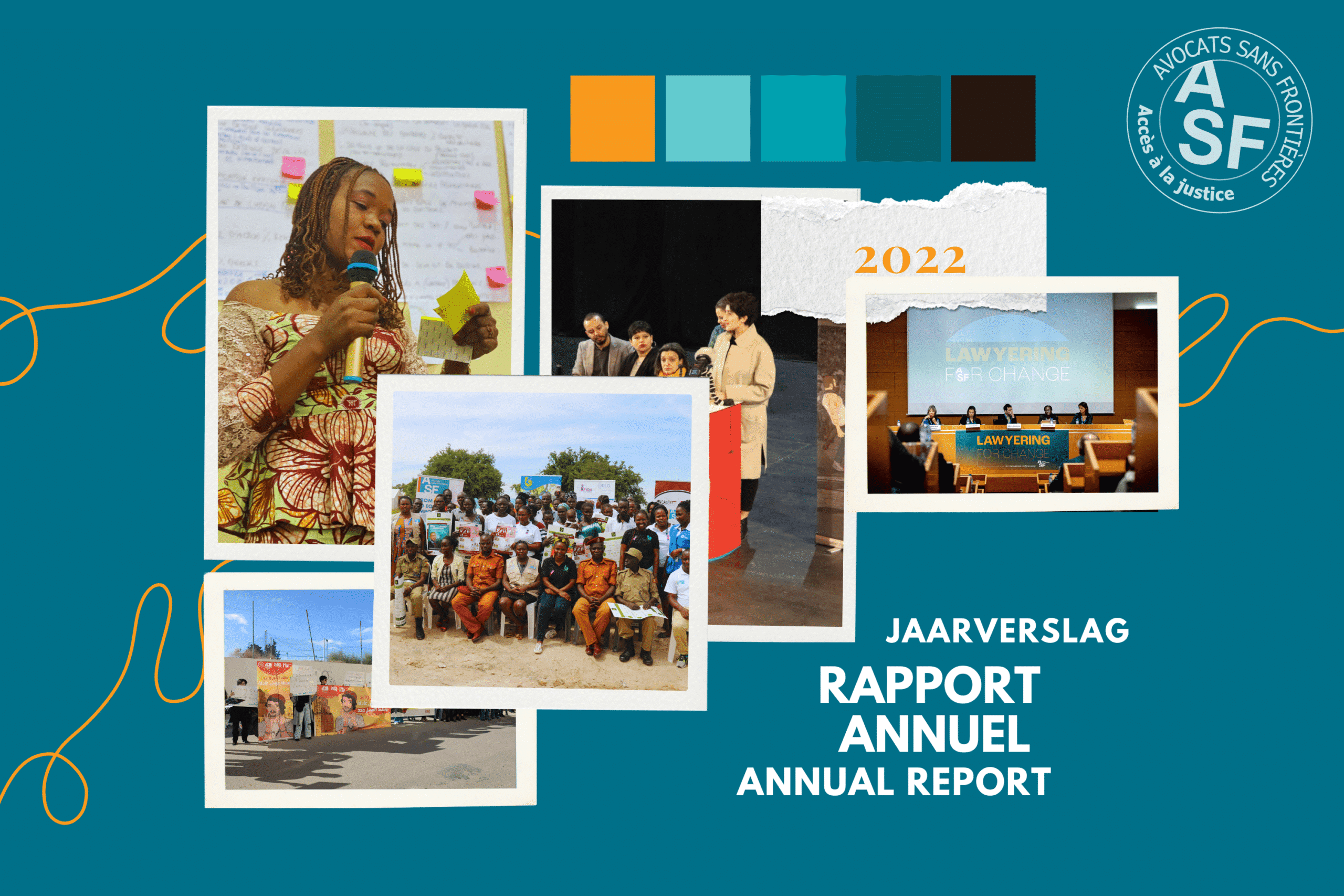Catégorie : Violences sexuelles
-
Promouvoir l’accès à la justice des femmes en Ouganda : le projet FATE et les perspectives à venir
En Ouganda, la promesse de justice reste inégalement réalisée. Malgré un cadre juridique solide et des réformes en cours, de nombreuses femmes et filles peinent encore à faire valoir leurs droits dans la pratique. Les inégalités structurelles, les normes sociales enracinées et l’écart entre les politiques et leur mise en œuvre continuent de limiter l’accès…
-
Impact de l’état de siège sur la justice pénale en Ituri
En mai 2021, l’État congolais a décrété un régime exceptionnel d’état de siège dans la province de l’Ituri pour tenter de mettre fin à plus de trois décennies de violence dans la région. L’ituri est le théâtre de guerres, d’insurrections et de violents conflits armés sur fond de crise de légitimité politique, de crise identitaire…
-
Le rapport annuel d’ASF est disponible !
L’équipe d’Avocats Sans Frontières est ravie de pouvoir vous présenter son dernier rapport annuel, maintenant disponible sur notre site.
-
ExPEERience Talk #9 – Le numérique au service des victimes et de la justice : le projet Back-up de We are NOT Weapons of War
Pour ce 9ème ExPEERience Talk, nous sommes ravi.e.s de recevoir Céline Bardet, fondatrice de l’organisation We are NOT Weapons of War (WWOW) qui a pour mandat de lutter contre les violences sexuelles dans les conflits, notamment contre le viol comme arme de guerre. Elle reviendra sur l’importance, face à ces enjeux, de l’accompagnement – notamment…
-
Les cliniques juridiques pour soutenir l’accès à la justice en temps de pandémie
Partout dans le monde, la pandémie a éloigné encore un peu plus les justiciables de la justice. Au Maroc, ASF mise depuis plusieurs années sur des cliniques juridiques, installées dans des universités, pour promouvoir l’accès à la justice, particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Sous la supervision d’enseignant.e.s et de professionnel.le.s du droit,…
-
Lutte contre les violences basées sur le genre au Myanmar : l’expérience d’un avocat pro bono
Les violences basées sur le genre constituent une problématique socio-économique importante au Myanmar. En collaboration avec ActionAid International, ASF fournit expertise technique et conseils pour améliorer l’accès à la justice pour les personnes à risque et/ou ayant souffert de telles violences. Membre de l’International Legal Network d’ASF, Lionel Blackman, a contribué bénévolement au projet. Il…
-
ASF en RD Congo: 15 ans d’engagement
Il y a 15 ans, presque jour pour jour, ASF ouvrait son premier bureau à Kinshasa et démarrait ses activités en faveur de l’état de droit en RD Congo. L’organisation y est toujours active aujourd’hui, engagée pour garantir à la population l’accès à une justice de qualité. Que d’avancées, depuis nos débuts! Que de rencontres,…
-
« L’homme qui répare les femmes »
Lors de la soirée « Justice & Impunité » qui se déroulera à Bruxelles, ce jeudi 30 avril, le public aura l’occasion de découvrir le film, « L’homme qui répare les femmes ». Ce documentaire retrace la lutte incessante du docteur Mukwege contre les violences sexuelles dont sont victimes des milliers de femmes à l’est…