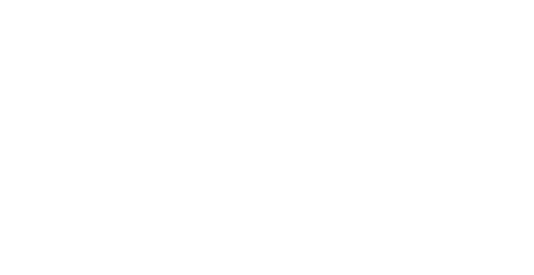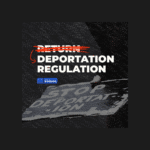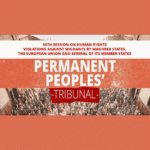La surpopulation carcérale et la sur-représentation des détenu·e·s préventif·ve·s en République démocratique du Congo sont des faits bien documentés. Mais que révèlent ces chiffres sur les logiques profondes qui guident la justice pénale ?
ASF publie l’étude Pratiques et logiques sociales du placement en détention préventive à Kinshasa qui s’intéresse aux discours, aux pratiques et aux représentations des magistrat·e·s du Parquet à Kinshasa. Menée dans une perspective d’anthropologie juridique, ses conclusions sont sans appel : loin de se limiter à une simple application de la loi, la détention préventive s’inscrit dans un système pénal régit, entre autres, par les logiques sociales de pouvoir, d’autoprotection et d’humiliation.
Une inversion du principe constitutionnel consacrant la liberté
Là où la Constitution consacre la liberté comme principe et la détention comme exception, la pratique judiciaire tend à suivre un schéma inverse. L’incarcération est devenue la norme, un réflexe qui s’impose en raison des dynamiques professionnelles et contextuelles à l’œuvre.
La figure toute-puissante du·de la magistrat·e
Les magistrat·e·s du Parquet se perçoivent comme une figure de noblesse et une incarnation de l’autorité de la Loi. Un·e magistrat·e s’affirme par sa capacité à ordonner des arrestations. Cette position d’autorité et de puissance fonde, du point de vue du·de la magistrat·e, la légalité et l’éthique de sa décision.
Une justice sous pression
Si les magistrat·e·s du Parquet insistent sur l’examen au cas par cas et sur la gravité des faits, l’étude met en lumière d’autres considérations qui influencent leurs décisions. Le risque de mise en cause par leur hiérarchie ou par les victimes pousse certain·e·s à prendre des décisions conservatrices, renforçant ainsi la logique d’incarcération. La pression exercée par les supérieur·e·s hiérarchiques, conjuguée à la porosité entre les sphères judiciaire, politique et économique, restreint les marges de manœuvre des magistrat·e·s. Les magistrat·e·s sont confronté·e·s à des « ordres cachés », de la part du pouvoir politique ou de leur hiérarchie. Le non-respect de ces ordres les exposent à des sanctions qui s’inscrivent dans une culture de l’humiliation et de la soumission aux rapports de force.
La monétarisation de la liberté
La détention préventive s’inscrit aussi dans un système de négociations et de marchandisation de la justice. Le règlement amiable de certains faits bénins permet d’éviter des procédures longues et coûteuses, mais il s’accompagne aussi de pratiques douteuses où le paiement d’amendes transactionnelles ou de cautions se confond avec des exigences de pots-de-vin. Dans ce contexte, le soupçon est généralisé. Les conflits internes au sein du Parquet, notamment entre magistrat·e·s et secrétaires de Parquet, ajoutent une dimension supplémentaire d’opacité à ces procédures.
Une régulation sociale qui pénalise la liberté
Les résultats de l’étude montrent que la détention préventive n’est pas qu’une question de droit, mais un véritable mécanisme de régulation sociale. La logique du soupçon, la peur des sanctions hiérarchiques et les relations de pouvoir entre les différent·e·s acteur·rice·s judiciaires contribuent à une dynamique où la privation de liberté devient une réponse systématique. Cette situation met en péril le principe fondamental de la présomption d’innocence et illustre les limites profondes du système judiciaire congolais.
Cette étude constitue un appel à repenser les pratiques judiciaires et à renforcer le respect des droits fondamentaux. Elle rappelle que la justice ne peut se résumer à une simple application des textes : elle est aussi le reflet des dynamiques sociales qui la traversent. Rendre à la liberté sa place de principe plutôt que d’exception est un défi majeur pour les acteur·rice·s judiciaires et les défenseur·euse·s des droits humains.