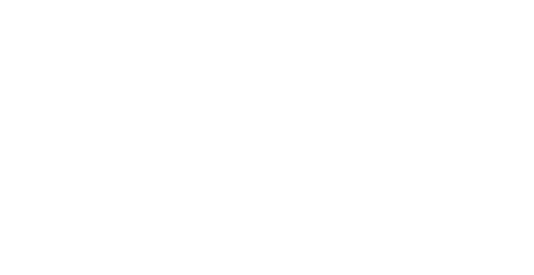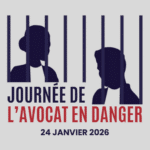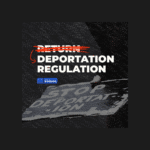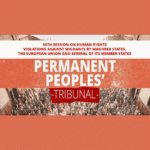Le sans-chez-soirisme1 est un problème de plus en plus visible en Belgique, malgré les discours politiques promettant des solutions. Au lieu de bénéficier d’une approche de soutien, les personnes sans-chez-soi sont souvent confrontées à des mesures répressives qui aggravent leur précarité. Dans un Policy Brief publié le 07 avril, ASF met en lumière cette dynamique préoccupante et propose des pistes de réformes pour une gestion plus humaine et plus efficace du sans-chez-soirisme dans le cadre de la Campagne mondiale pour Décriminaliser la pauvreté et le statut.
Les mesures répressives, loin de garantir des solutions durables au sans-chez-soirisme, perpétuent un cercle vicieux de stigmatisation et d’exclusion sociale, en particulier pour les populations les plus vulnérables. La criminalisation de la pauvreté ne fait qu’empirer les inégalités existantes. Ces pratiques répressives, au lieu de protéger les plus vulnérables, renforcent également leur marginalisation.
Les conséquences de ce type de mesures sont dramatiques : un coût humain et financier élevé, une stigmatisation accrue, et l’aggravation de la précarité. Face à cette approche punitive, ce Policy Brief met avant plusieurs recommandations nécessaires pour une approche plus inclusive, respectueuse des droits humains et axée sur la justice sociale.
Recommandations
- Mettre fin à la criminalisation des personnes sans-chez-soi pour ce qu’elles sont
Le premier axe de recommandations concerne les autorités locales, qui ont un rôle clé dans la gestion du sans-chez-soirisme. Il est impératif de supprimer les règlements anti-mendicité et autres législations répressives qui criminalisent des comportements directement liés à la situation de pauvreté, tels que dormir dans la rue ou occuper des lieux abandonnés. Le Policy Brief évoque également la révision des politiques de sanctions administratives, qui ne font qu’aggraver la situation en les enfonçant davantage dans l’endettement et la précarité.
Les communes doivent également uniformiser l’accès aux droits sociaux et garantir une prise en charge adaptée des personnes sans-chez-soi. Les pratiques discriminatoires doivent être abandonnées, et les CPAS (Centres Publics d’Action Sociale) doivent offrir un accès équitable à l’aide sociale, en particulier pour les primo-arrivant·e·s.
Enfin, il est essentiel de garantir une approche préventive, plutôt que répressive, dans les services de polices, et de renforcer la formation des forces de polices et les administrations locales pour lutter contre la criminalisation du sans-chez-soirisme.
- Déconstruire les préjugés et la stigmatisation des sans-chez-soi
Un autre levier d’action dans la lutte contre la criminalisation du sans-chez-soirisme est la déconstruction des préjugés, notamment ceux qui stigmatisent en raison de l’origine, du statut social ou de l’état de santé. Les médias, responsables politiques et la société civile jouent un rôle crucial pour diffuser un contre-narratif fondé sur la dignité humaine et la justice sociale.
Les discours discriminatoires doivent être activement combattus, et la parole des personnes sans-chez-soi doit être au centre des débats pour que leurs besoins réels soient entendus et pris en compte dans la construction des politiques publiques.
- Lutter contre les causes structurelles du sans-chez-soirisme
Le Policy Brief insiste sur l’importance de garantir l’accès au logement pour tou·te·s, en s’inspirant de modèles de réussite comme le programme Housing First. Ce dernier assure un accès immédiat au logement accompagné de soutiens adaptés et a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays.
Le logement social doit également être renforcé, avec des politiques de maintien en logement qui protègent les personnes contre les expulsions et garantissent des alternatives adaptées en cas de perte de logement. L’encadrement des loyers et l’augmentation des aides au logement sont essentiels pour éviter la précarité liée à l’habitat.
En outre, il est urgent de repenser le recours à la prison pour les délits mineurs et de renforcer les alternatives à l’incarcération, en particulier pour les sans-chez-soi. En parallèle, une meilleure prise en charge des troubles psychiques et des addictions est nécessaire. Le recours à la répression des comportements liés à l’alcoolisme ou à la consommation de drogues doit être remplacé par des dispositifs de soutien adaptés, permettant une prise en charge médicale et sociale efficace.
Enfin, il est recommandé de réviser les politiques concernant les personnes sans-papiers et les demandeur·euse·s d’asile, notamment en préconisant des mesures de régularisation et un accès inconditionnel à l’hébergement.
Pour en finir avec la criminalisation des personnes sans-chez-soi, la Belgique doit adopter une approche radicalement différente, fondée sur l’inclusion, la dignité, et l’accès aux droits sociaux. Les réformes proposées visent ainsi à mettre fin à la logique punitive et à lutter contre les causes profondes de la pauvreté.
- Dans cette étude, les termes « sans-chez-soirisme » et « sans-chez-soi » sont utilisés en lieu et place des expressions « sans-abrisme » et « sans-abri », souvent perçues comme trop réductrices ou connotées négativement. Ces nouvelles dénominations permettent une meilleure reconnaissance de la diversité des situations et des parcours des personnes concernées, tout en valorisant une approche plus inclusive et respectueuse.
↩︎