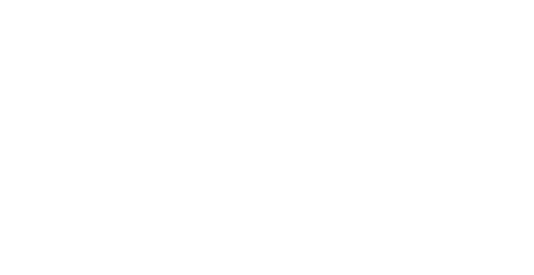Catégorie : Nord
-
Décriminaliser et dé-sécuritiser les migrations et la pauvreté : Plaidoyer pour une approche non-discriminatoire des politiques européennes
L’Union européenne s’est progressivement départie de ses valeurs fondatrices de solidarité et de non-discrimination, pourtant consacrées dans le droit international, et traverse de ce fait une crise de légitimité démocratique et morale. Dans ce Policy Brief, basé sur les discussions tenues lors du Sommet européen des citoyens, ASF invite l’UE à cesser de considérer la…
-
Transitional Justice & Historical Redress : Une série spéciale sur les injustices historiques découlant de l’esclavage et du colonialisme
Tout au long des prochaines semaines, ASF publiera une série d’articles qui examineront les défis et les questions que soulèvent l’essor récent de processus visant à offrir une réponse aux injustices historiques découlant de l’esclavage et du colonialisme, en particulier dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Cette série spéciale le fruit d’une collaboration…
-
Commission Vérité et Réconciliation : la Belgique face à l’opportunité d’adresser les préjudices nés de son passé colonial
Longtemps reléguée à l’arrière-plan du débat public, la question des préjudices nés de la colonisation trouve aujourd’hui un nouveau souffle en Europe, et en Belgique tout particulièrement. Une proposition de Commission Vérité Réconciliation est à l’heure actuelle débattue par les Parlementaires belges. La Belgique dispose donc d’une opportunité historique de faire face à son passé…