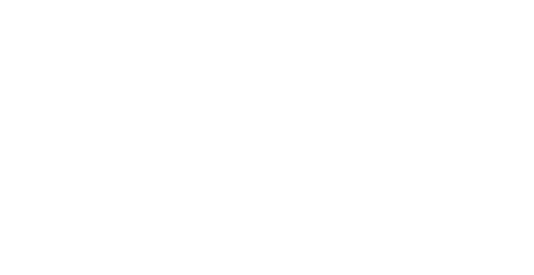L’arrestation judiciaire est un acte constitutif d’une privation de liberté visant à mettre un individu à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la recherche, la poursuite et la répression des infractions. Elle n’est permise que pour les crimes ou les délits, et non pour les contraventions.
Quant à la durée de la privation de liberté, celle-ci doit cesser dès qu’elle n’est plus nécessaire. Dans tous les cas, elle ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf décision motivée du juge d’instruction (par le biais d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de prolongation) signifiée dans les vingt-quatre heures. Le point de départ dudit délai est le moment de la privation effective de la liberté d’aller et de venir. Un procès-verbal (mentionnant notamment l’heure exacte de l’arrestation) doit être dressé pour permettre une vérification ultérieure de la régularité de l’arrestation judiciaire.
Il convient de ne pas confondre « arrestation judiciaire » avec « arrestation administrative ». La première vise la recherche, la poursuite et la répression des infractions, tandis que la seconde vise le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.
Bases légales:
- Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Article 12 de la Constitution belge.
- Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Pour aller plus loin :
- M.BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres, éd. Jeunesse & Droits, 2014, pp. 165 à 201.
- C.BOTTAMEDI et C. ROMBOUX, Vade-mecum du policier de terrain, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 51 à 57.
- M-A. BEERNAERT, Détention préventive, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 9 à 21.
- C. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 459 à 476.