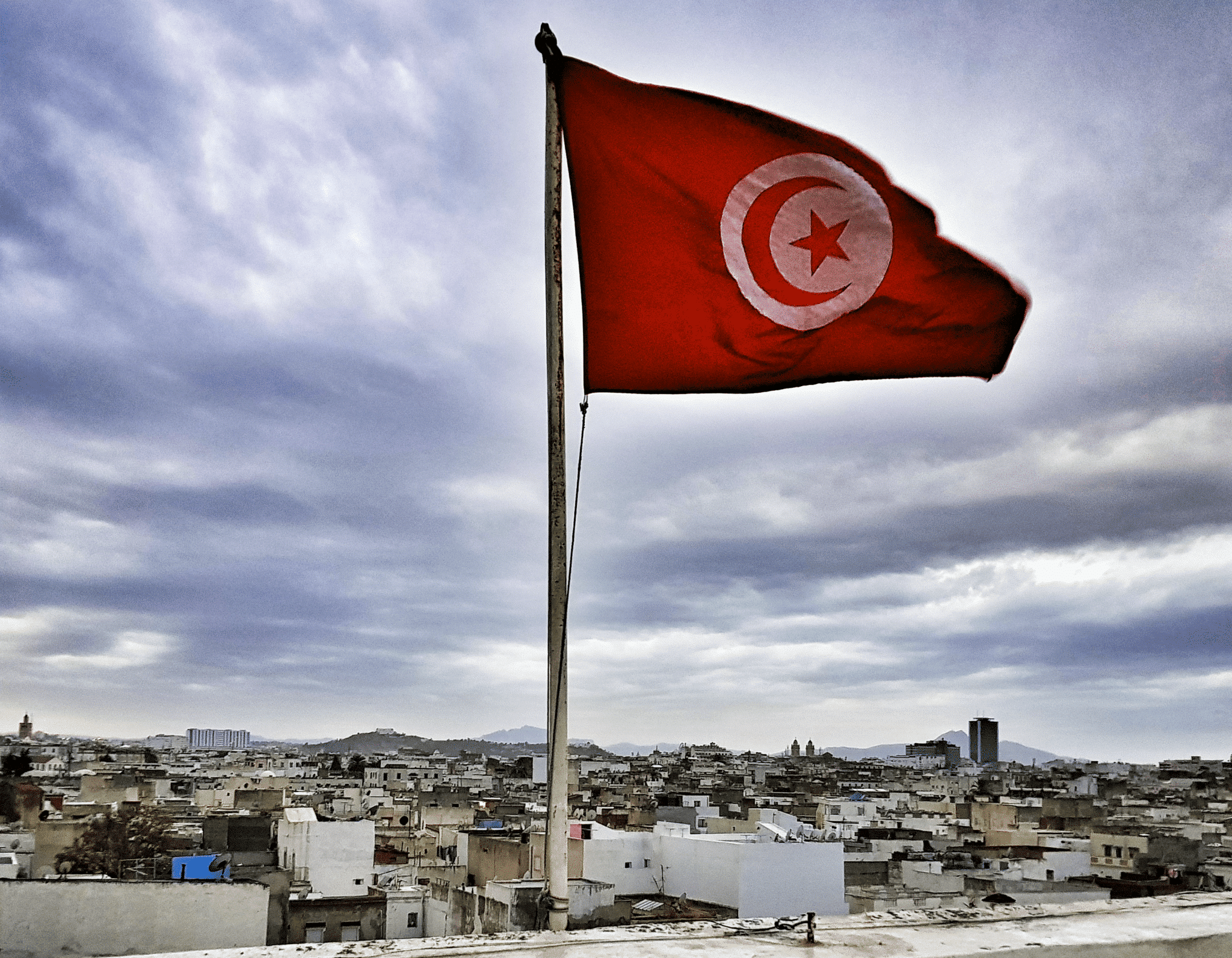
Auteurs : Antonio Manganella, Oumayma Mehdi, Elisa Novic, Johanna Wagman, Ragheb Zouaoui
Une riposte normative graduée
Alors que la pandémie du Covid-19 rentrait dans une phase de pic en Chine et se faisait de plus en plus menaçante en Europe, la Tunisie a très rapidement déployé une réponse préventive, consciente de la faiblesse de son système sanitaire pour contenir une telle crise. Les premières mesures remontent ainsi au 26 janvier, avec l’installation de caméras thermiques et, début mars, le développement de pratiques d’isolement pour personnes symptomatiques et d’auto-confinement de 14 jours pour personnes asymptomatiques provenant de zones à risque.[1]
La réponse s’est en effet accélérée le 2 mars 2020, avec la détection d’un premier cas avéré en provenance de Milan, qui a poussé l’État tunisien à franchir un nouveau seuil dans l’adoption de mesures visant à endiguer la pandémie.[2] Alors que la courbe des contaminations continuait de croître, le Président de la République a annoncé, le 18 mars 2020, un couvre-feu général,[3] suivi le 21 mars 2020 par l’adoption d’une déclaration de confinement sanitaire général,[4] proclamant par là-même l’état d’exception en vertu de l’article 80 de la Constitution. Le 12 avril 2020, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) votait l’extension provisoire des prérogatives du Chef du Gouvernement, sur le fondement de l’article 70 de la Constitution.[5]
Un arsenal juridique inadapté en temps de pandémie
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution en 2014, les mécanismes prévus par les articles 70 et 80 de la Constitution tunisienne n’avaient encore jamais été activés. Pour faire face aux défis sécuritaires liés à la menace terroriste et l’instabilité du voisin libyen, l’exécutif recourait jusqu’alors à l’état d’urgence, prévu par le Décret n° 78-50 du 26 janvier 1978. L’état d’urgence a d’ailleurs été renouvelé une énième fois durant la période de lutte contre la pandémie COVID-19, sans lien évident avec la lutte au virus.[6]
Ce décret est déjà largement dénoncé par la société civile du fait de son caractère inconstitutionnel et obsolète,[7] dans la mesure où son origine remonte à la répression des manifestations organisées en 1978 par l’UGTT contre le régime dictatorial et les violations des droits humains. L’instauration du couvre-feu dans le cadre de l’état d’urgence repose ensuite sur les gouverneurs, des entités affiliées au ministère de l’intérieur et non à la Présidence de la République,[8] ce qui pouvait induire un risque potentiel d’un déphasage ou d’une disparité au niveau de la la réponse à la crise sanitaire, qui nécessitait une réponse rapide.[9]
Les instruments législatifs relatifs à la santé publique ne permettaient pas non plus une réponse à la portée de la Covid-19. La loi 92-71 relative aux maladies transmissibles se limite en effet à l’hospitalisation d’office des personnes atteintes d’une des maladies listées, pour les personnes refusant de se soigner ou adoptant des comportements à risque.
L’article 70 de la Constitution, prévoyant la délégation de pouvoir de la part de l’ARP au gouvernement, aurait sans doute pu remplir ce rôle bien plus tôt dans la chronologie des évènements, si ce n’est que la Tunisie se trouvait alors en pleine crise politique suite aux élections législatives d’octobre 2019. Aucune majorité claire n’était alors ressortie, ralentissant la formation d’un gouvernement. Par principe, un gouvernement en affaires courantes ne peut prétendre aux pouvoirs spéciaux prévus par l’article 70, lui permettant de légiférer en lieu et place de l’ARP sous forme de décrets-lois. Ce n’est que le 27 février 2020 que le gouvernement d’Elyes Fakhfakh a obtenu la confiance des députés. Un mois plus tard, c’était donc un Chef du Gouvernement dont la légitimité était encore à construire, qui déposait un projet de loi d’habilitation devant l’ARP, qui a finalement été votée, après près de deux semaines de débats.
Le Président de la République aurait dans ces conditions pu déposer lui-même un projet de loi,[10] ce qui aurait permis de respecter les termes de l’article 49 de la Constitution qui prévoit que les restrictions aux droits et libertés fondamentales des tunisiens doivent être prévues par la loi et uniquement dans le but de « répondre aux exigences d’un État civil et démocratique », dont la « sauvegarde (…) de la santé publique » fait partie. Elles doivent en outre être susceptibles de contrôle juridictionnel. Il est important de noter ici que les principaux instruments internationaux et régionaux de protection des droits humains mettent également l’accent sur le rôle des Parlements dans la limitation des droits et libertés,[11] en particulier dans les contextes d’urgence.[12]
Le Président de la République, Kaïs Saïed, a pourtant choisi, sans doute par souci de célérité, de recourir au mécanisme le plus exceptionnel qui soit, la proclamation de l’état d’exception prévu par l’article 80 de la Constitution, faisant ainsi acte d’un « péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Cette disposition n’évoque pas le statut des droits et libertés une fois l’état d’exception proclamé, ce qui avait déjà alimenté beaucoup de craintes lors de son adoption.[13] Si l’article 80 peut poser question en termes d’adéquation pour répondre à une crise sanitaire, son déclenchement est surtout venu perpétuer une situation foncièrement inconstitutionnelle, dans la mesure où il est conditionné à la consultation des plus hautes instances de l’Etat, y compris le Président de la Cour constitutionnelle. Cette dernière doit, en outre, pouvoir être saisie, soit par le Président de l’ARP, soit par 30 députés, « pour statuer sur le maintien de l’état d’exception » à l’issue d’une période de trente jours après l’entrée en vigueur des mesures d’exception. Or, il n’existe pas en Tunisie de Cour Constitutionnelle, et ce malgré le fait que la Constitution encadre par de stricts délais la mise en place de la haute instance garante de l’équilibre des pouvoirs et de l’Etat de droit. A ce jour, la Tunisie accumule un retard de près de cinq ans vis-à-vis des exigences constitutionnelles.[14]
Le contrôle démocratique de l’exécutif par l’ARP
L’on comprend mieux les réticences de l’ARP à voter dans ce contexte l’habilitation du gouvernement à légiférer, dans la mesure où cette institution constituait le dernier garde-fou prévu par l’article 80, qui prévoit qu’elle siège en « session permanente » pendant tout le temps que dure l’état d’exception. Les députés ont tout de même limité le risque de monopole du pouvoir par l’exécutif. La loi d’habilitation, adoptée le 12 avril 2020, est en fait une version amendée du projet de loi déposé par l’exécutif, dont la portée a finalement été strictement limitée à la période de riposte contre la Covid-19. Le pouvoir de réglementer les droits et libertés doit ainsi être mis en œuvre « de manière adaptée aux mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation et la transmission du Coronavirus, et ce, en conformité avec les exigences de l’article 49 de la Constitution. »[15] Selon l’article 70, ces décrets-lois adoptés par le gouvernement sont soumis à l’ARP pour approbation à l’issue des deux mois suivant la délégation de pouvoirs. Pour éviter de ne se retrouver devant le fait accompli, l’ARP a, dans la loi d’habilitation, indiqué que les décrets-lois seraient examinés selon les mêmes procédures des « initiatives de loi ».[16] Cela permet ainsi que soit saisie l’Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois, notamment dans l’hypothèse où certaines mesures envisagées par l’exécutif seraient amenées à s’appliquer au-delà de la période de Covid-19.[17]
Le Président de la République n’a, suite à la loi d’habilitation, plus eu recours à l’article 80 de la Constitution. Les mesures de confinement ont progressivement été levées à partir du 4 mai ; celles de couvre-feu définitivement le 8 juin.
Tout est bien qui finit bien ?
Alors que la Tunisie est plongée dans un état d’urgence permanent depuis les attentats de 2015, le déclenchement tour à tour des deux dispositions constitutionnelles, les articles 70 et 80, renforçant les pouvoirs de l’exécutif pouvait légitimement susciter de fortes inquiétudes quant au respect de de l’état de droit et des principes démocratiques.
Si l’on observe une certaine prise de responsabilité de l’ensemble des décideurs politiques, tout juste sortis d’une crise institutionnelle de plusieurs mois, l’issue aurait pu être toute autre, eurent les personnes été différentes. Le fait que l’utilisation de tels pouvoirs puissent dépendre de la conscience individuelle des dirigeants témoigne de la faiblesse des réformes institutionnelles visant à mettre en œuvre les acquis constitutionnels hérités des gouvernants successifs depuis 2014.
Il va de soi que, si les nouveaux acteurs de la scène politique élus pour ce quinquennat veulent marquer une véritable rupture par rapport au quinquennat précédent, ils devraient faire de la mise en place des instances constitutionnelles de contrôle et, en tête, de la Cour Constitutionnelle, l’une des priorités de l’Assemblée des Représentants du Peuple, du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Président de la République.
Un acte de responsabilité fort est particulièrement attendu de la part de l’ARP, principale responsable de l’absence de Cour Constitutionnelle. Incapable pendant quatre ans de trouver le consensus nécessaire à l’élection des quatre membres dont le choix lui revient, l’ARP ne devrait d’ailleurs pas utiliser ses échecs répétés comme prétexte pour modifier la majorité requise pour une telle élection et ainsi compromettre l’indépendance de la haute instance et de ses membres.
D’ici la mise en place opérationnelle de la Cour constitutionnelle, le Président de la République devrait quant à lui se garder de recourir à l’article 80 de la Constitution et à la proclamation de l’état d’urgence en se basant sur un texte juridique inconstitutionnel qui viole les droits et libertés des citoyens.
Une révision du cadre juridique tunisien s’impose désormais pour tirer les leçons de cette crise pandémique et s’assurer que des mécanismes adaptés et proportionnés aux enjeux soient à l’avenir disponibles.
[1] Voir Inkyfada, Covid-19 : Chronologie de la gestion de l’épidémie en Tunisie (2020).
[2] Ces mesures ont inclus la fermeture de la majorité des établissements scolaires, le report des manifestations culturelles ainsi que des opérations médicales non urgentes, et la fermeture des frontières maritimes avec l’Italie.
[3] Décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République.
[4] La déclaration faisait suite au 1er cas de décès et fut entérinée dans le décret présidentiel n°2020-28 du 22 mars 2020. Cette mesure fut accompagnée de l’interdiction de déplacement sans autorisation en vertu du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
[5] Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à adopter des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus.
[6] Décret Présidentiel n° 2020-54 du 29 mai 2020, portant prorogation de l’état d’urgence.
[7] Un Projet de loi organique portant organisation de l’état d’urgence avait été déposé à l’ARP en 2019 par le précédent gouvernement, mais finalement abandonné sous la pression de la société civile, qui pointait le caractère flou et attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garanties. Pour plus d’informations, voir l’analyse développée par les organisations membres de l’Alliance Sécurité et Liberté (2019).
[8] En Tunisie, le pouvoir exécutif est bicéphale, avec à sa tête le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
[9] L’article 4 du Décret n°78-50 prévoit la possibilité, pour les gouverneurs, d’ordonner une interdiction de la circulation, mais pas de la limiter.
[10] Constitution de la République tunisienne (2014), art. 62 al. 1.
[11] E.g. sur la liberté de circulation voir i.a. Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, art. 12(2) Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) art. 12(3).
[12] PIDCP, ibid. art. 4 ; Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations, paras. 15-18.
[13] Voir i.a. The Carter Center, Le processus constitutionnel en Tunisie, Rapport final – 2011-2014, p. 92.
[14] Constitution de la République tunisienne (2014) art. 148 al 5.
[15] Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus, art. 1(2). En plus des dispositions sur les droits et libertés, la loi délègue i.a. au gouvernement le soin de légiférer sur les questions d’appui économique et fiscal aux acteurs économiques, l’organisation des mesures de prévention sanitaire, notamment dans les écoles, ainsi que l’encadrement de la fonction publique.
[16] Ibid. art. 3.
[17] Voir par exemple le Décret-Loi n°12/2020, mettant en place des audiences pénales à distance, et qui fait explicitement mention d’une application au-delà de la période pandémique.



