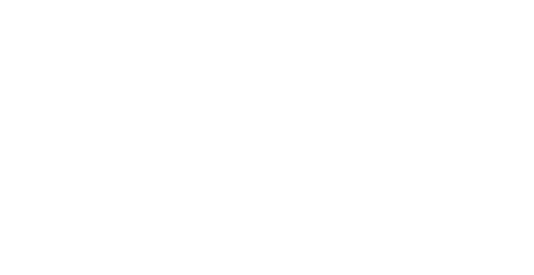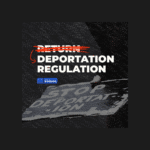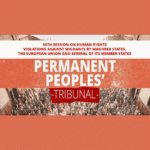Les défenseur·e·s des droits humains (DDH) en République centrafricaine jouent un rôle central dans la promotion de la paix, la consolidation de l’État de droit et la défense des libertés fondamentales. Malgré leur engagement crucial, ces acteur·rice·s évoluent dans un environnement caractérisé par l’insécurité, la stigmatisation, l’absence de mécanismes de protection efficaces et une structuration encore embryonnaire de leurs initiatives, notamment dans les régions éloignées de la capitale.
Pour les soutenir, Avocats Sans Frontières, en partenariat avec l’ONG URU et l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (IFJD), met en oeuvre le projet « Gbou Kôkô (Défendre) », avec le soutien financier de l’Union européenne. L’objectif général est de promouvoir et protéger les droits humains à travers le renforcement des capacités des DDH et le soutien à leur structuration. Le projet couvre Bangui, Bouar et Bambari, avec une attention particulière à leurs périphéries, souvent délaissées par les projets traditionnels.
Une approche innovante fondée sur les dynamiques locales
La spécificité du projet Gbou Kôkô réside dans son approche profondément enracinée dans les réalités communautaires et dans sa volonté de s’émanciper des circuits classiques des OSC les plus visibles et les plus institutionnalisées. L’approche repose sur une compréhension approfondie et évolutive des dynamiques de la société civile centrafricaine, où de nombreux défenseur·e·s des droits humains agissent de manière isolée, sans toujours se reconnaître comme tel·le·s, et perçoivent parfois cette mission comme un privilège réservé à une élite ou à un cercle restreint d’acteur·rice·s de la société civile.
Gbou Kôkô se positionne délibérément en dehors des sentiers battus, en valorisant :
- Les acteur·rice·s non-affilié·e·s à des structures formelles mais reconnu·e·s pour leur engagement local ;
- Les initiatives protéiformes qui émergent de contextes communautaires diversifiés, souvent en dessous des radars institutionnels ;
- Les zones géographiques marginalisées, comme l’intérieur du pays, où les voix citoyennes peinent à se faire entendre.
Cette approche permet de repérer, former et accompagner des DDH isolé·e·s mais engagé·e·s, qu’il·elle·s soient membres de comités locaux, des figures communautaires, ou de simples citoyen·ne·s volontaires.
Le projet a permis la formation de plus de 150 DDH, dont près de 40 % de femmes, à travers des sessions tenues à Bambari, Bouar et Bangui. Les modules abordaient les notions de droits humains, de monitoring, de collecte de données, de plaidoyer et d’analyse de l’espace civique.
Un point saillant : les bénéficiaires ont exprimé qu’ils ne se reconnaissaient pas initialement comme DDH, rôle qu’ils pensaient réserver aux membres d’organisations formelles. Le projet a donc soutenu une prise de conscience élargie du rôle que chacun peut jouer dans la défense des droits.
Création d’un dispositif de monitoring
L’une des avancées majeures du projet est l’élaboration collective d’un outil de suivi des violations des droits humains, avec un processus participatif associant points focaux, releveurs, et DDH. Le déploiement de fiches adaptées et l’utilisation de Kobo Collect ont permis la remontée d’un peu plus de 150 cas de violations en mars 2025, classifiés et analysés.
Ces données alimentent une base de documentation qui constitue une source précieuse pour le développement d’un plaidoyer collectif basé sur des données probantes (approche evidence-based).
Développement d’actions de plaidoyer ancrées localement
Des initiatives de plaidoyer et de sensibilisation ont émergé directement des sessions de formation et ont finalement pu être soutenues par de petit financement, donnant lieu à des micro-projets qui seront directement mis en œuvre par les DDH en 2025. À Bouar, les DDH ont décidé de s’attaquer aux violences sexuelles en milieu scolaire et aux problèmes d’accès aux papiers civils pour les communautés marginalisées. À Bambari, ils ont ciblé les tracasseries routières par les forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie) et leurs conséquences économiques sur la population. Á Bangui, les DDH ont décidé de travailler sur les violences sexuelles dans les milieux scolaires, l’accès des jeunes filles à l’éducation ainsi que sur les violations commises par les forces de défenses et de sécurité intérieure.
En parallèle, à Bangui, un suivi de la proposition de loi sur la protection des DDH est mené, impliquant un dialogue avec les institutions et les réseaux parlementaires.
Le projet Gbou Kôkô illustre comment une approche locale, inclusive et flexible peut renforcer durablement les capacités des défenseur·e·s des droits humains, surtout au niveau des provinces avec des initiatives locales pilotées par les DDH eux·elles-mêmes. En valorisant les acteur·rice·s invisibles, en sortant des partenariats classiques et en s’appuyant sur une documentation rigoureuse, il pose les bases d’une société civile plus représentative, plus structurée et plus apte à influencer le changement.
Les résultats obtenus – bien que perfectibles – montrent qu’il est possible de soutenir une dynamique de plaidoyer ascendante, portée par des DDH qui comprennent désormais mieux leur rôle et leur pouvoir d’agir.