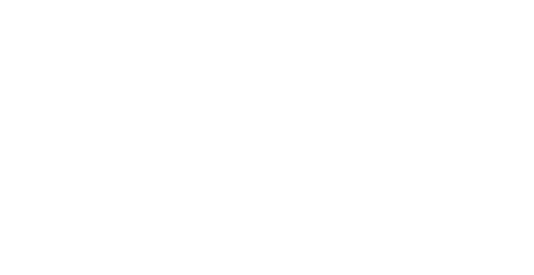Catégorie : Pro bono
-
Lutte contre les violences basées sur le genre au Myanmar : l’expérience d’un avocat pro bono
Les violences basées sur le genre constituent une problématique socio-économique importante au Myanmar. En collaboration avec ActionAid International, ASF fournit expertise technique et conseils pour améliorer l’accès à la justice pour les personnes à risque et/ou ayant souffert de telles violences. Membre de l’International Legal Network d’ASF, Lionel Blackman, a contribué bénévolement au projet. Il…
-
Myanmar: les « pro bono » en action
Myanmar – La phase pilote du projet de Centres pour l’état de droit est maintenant terminée. Ce projet vise à renforcer les compétences des professionnels du droit et de la société civile en matière justice, ainsi qu’à les encourager à intégrer les principes de l’état de droit dans leur travail. Sept experts légaux, membres de…
-
« Fournir de l’aide légale, c’est donner de l’espoir »
Afin de soutenir l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, encourager l’aide légale gratuite est primordial. Avocats Sans Frontières, en partenariat avec l’ Uganda Law Society, mobilise des avocats pour défendre les droits fondamentaux des Ougandais. Akello Suzan Apita fait partie des 16 avocats engagés dans cette action.
-
A la recherche de juristes experts pro bono
L’International Legal Network d’Avocats Sans Frontières offre la possibilité aux avocats de s’engager bénévolement en faveur des populations vulnérables en besoin d’assistance judiciaire. Aujourd’hui pourtant, malgré ses 800 membres, ce réseau manque de professionnels du droit spécialisés dans des domaines spécifiques comme la justice pénale internationale ou encore l’organisation de services d’aide légale.
-
Aux 500 professionnels du droit engagés aux côtés d’ASF : merci !
L’International Legal Network (ILN), le Réseau international des avocats créé par ASF en 2010, a le plaisir d’accueillir son 500e membre. L’arrivée de ce nouveau membre témoigne de la solidarité des professionnels du droit en faveur des justiciables pris en charge par ASF
-
Du Barreau de Bruxelles au tribunal d’Haïfa
Maître Maryse Alié est avocate au Barreau de Bruxelles et membre de l’International Legal Network d’ASF. Dans ce cadre, elle a participé à plusieurs missions d’observation judiciaire du procès emblématique « Rachel Corrie » à Haïfa (Israël), et animé au Burundi des sessions de formation sur le rôle de l’avocat dans la prévention du crime de torture.…