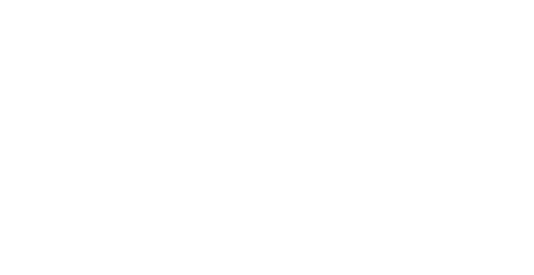Pays : Niger (la)
-

Promouvoir le respect des droits humains au Niger
ASF est engagée au Niger depuis 2023 pour promouvoir le respect des droits humains, notamment dans le domaine de la privation de liberté, mais aussi pour les populations en situation de vulnérabilité et vivant dans des zones reculées dans le cadre du projet « Promouvoir et protéger les droits et libertés collectifs et individuels au Niger…
-
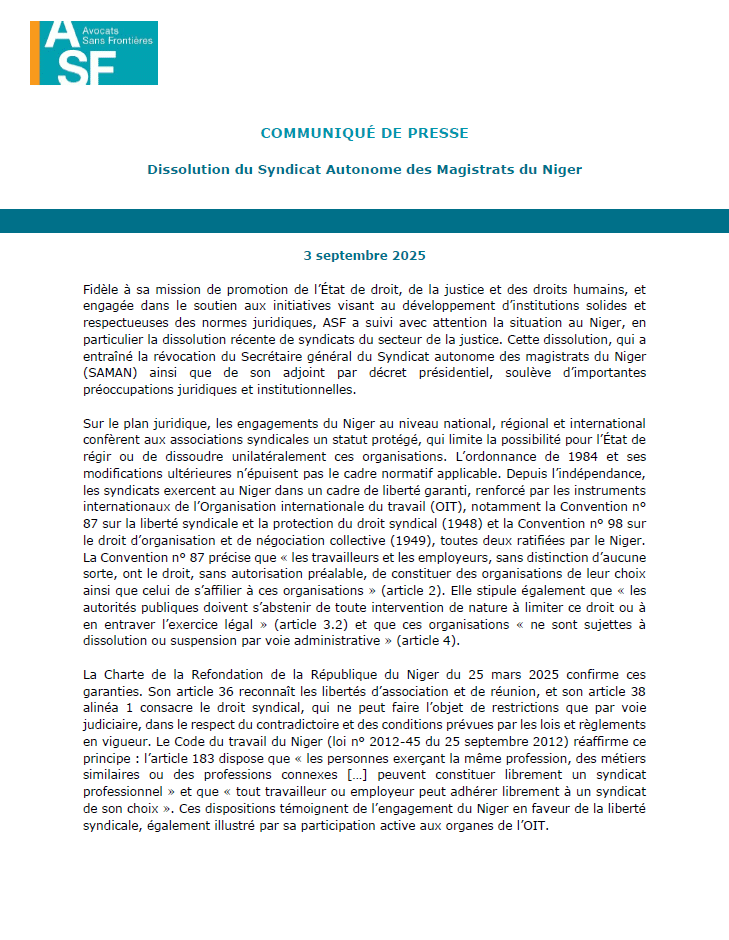
-

ASF publie son rapport annuel 2024 : défendre les droits humains dans un monde en repli
Avocats Sans Frontières (ASF) publie aujourd’hui son rapport annuel 2024, celui-ci rend hommage à celles et ceux qui, partout dans le monde, mettent leur liberté – et parfois leur vie – en jeu pour défendre les droits fondamentaux.
-

-
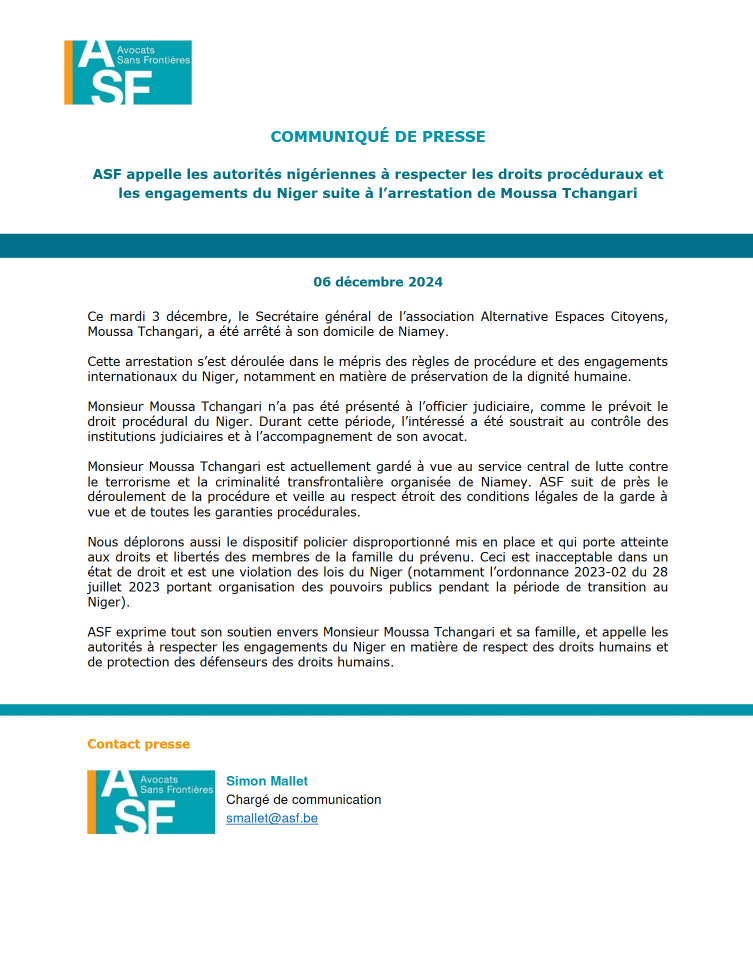
-
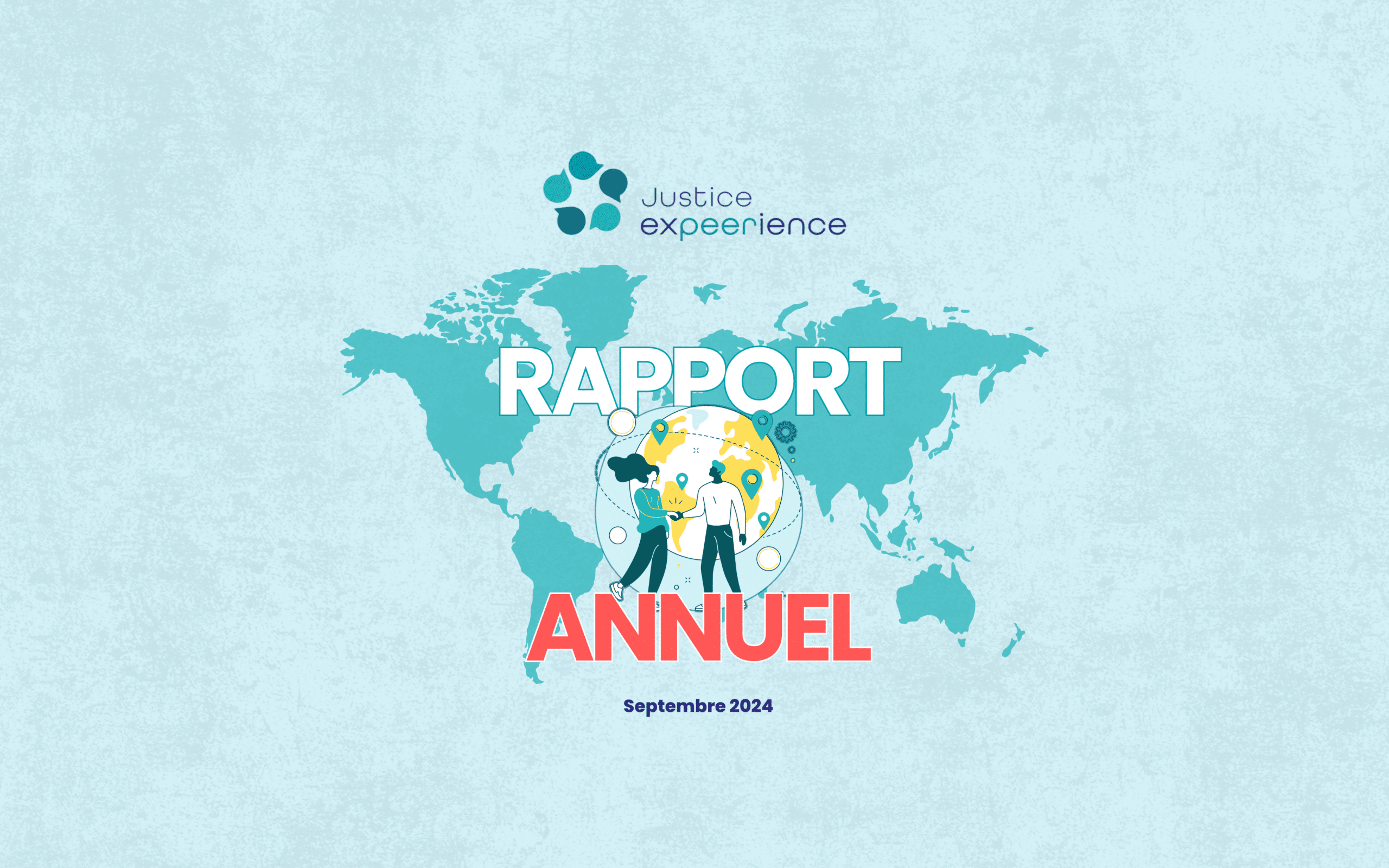
Le réseau Justice ExPEERience continue de grandir : bilan et nouveautés
Justice ExPEERience a fêté cet été ses 3 ans d’existence ! À cette occasion, l’équipe de coordination du réseau est fière de vous présenter le rapport annuel de Justice ExPEERience.
-

-
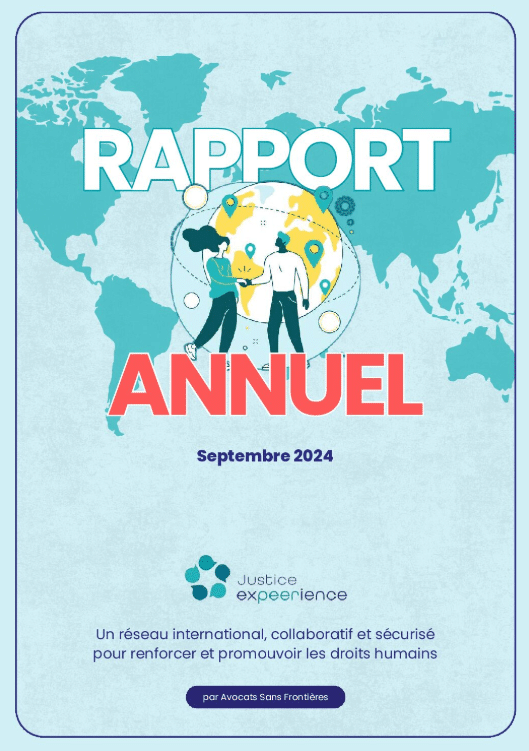
-

Travailler au Niger dans le contexte post-coup d’État
Depuis l’ouverture du bureau ASF au Niger en 2023, le pays a connu d’importants bouleversements politiques, dont le coup d’État de juillet 2023. Dans cet article, nous revenons sur la manière dont ASF et ses partenaires ont adapté leur action à ce nouveau contexte afin d’accompagner au mieux les populations locales dans leurs besoins de…
-
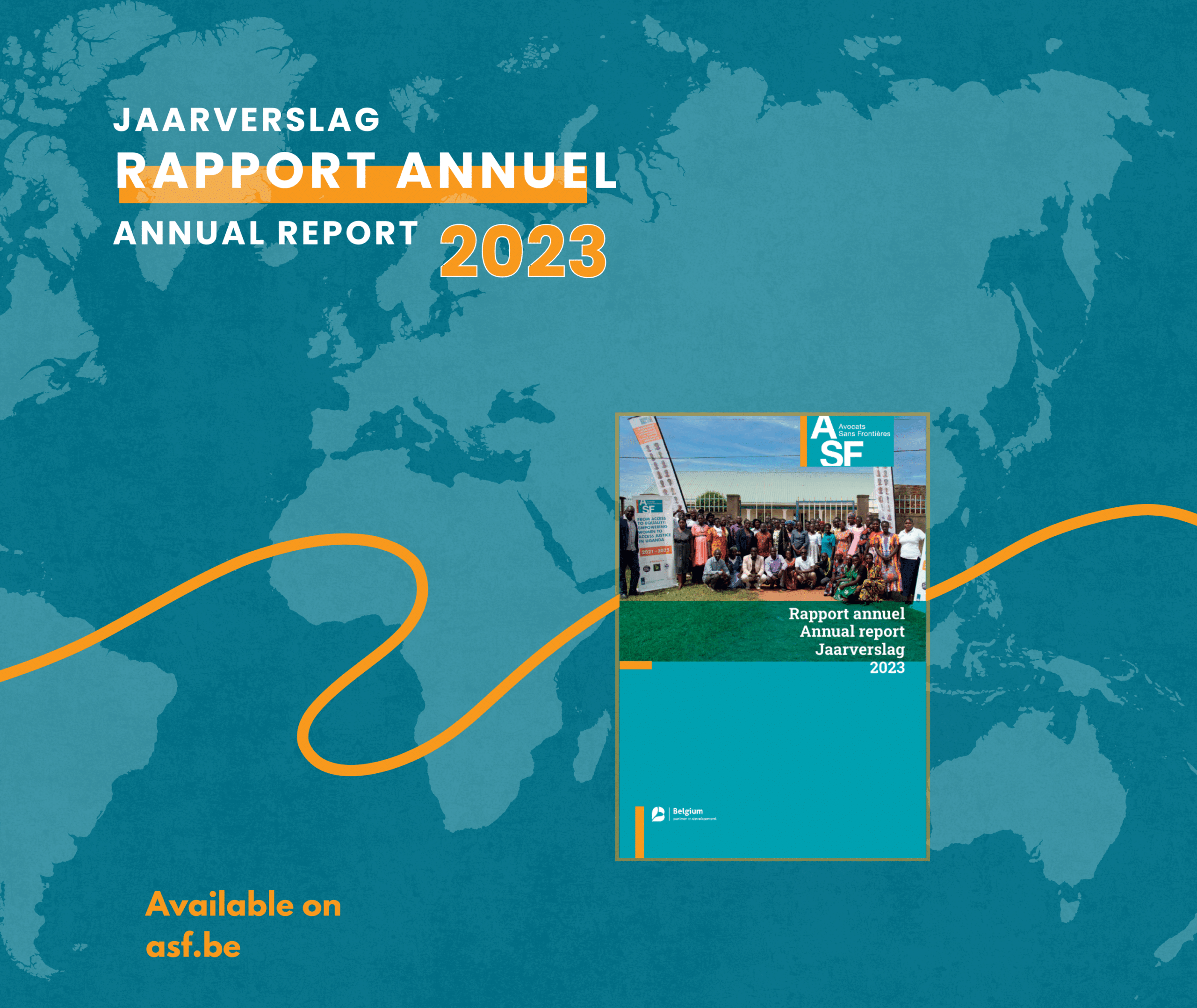
Le dernier rapport annuel d’ASF est disponible !
ASF vient juste de publier son rapport annuel 2023. L’organisation y évoque les nombreux défis auxquels elle fait face à l’heure de la montée des autoritarismes et de la remise en cause du principe des droits humains et de l’État de droit partout à travers le monde. Face à ces défis, ASF s’adapte, adapte ses…