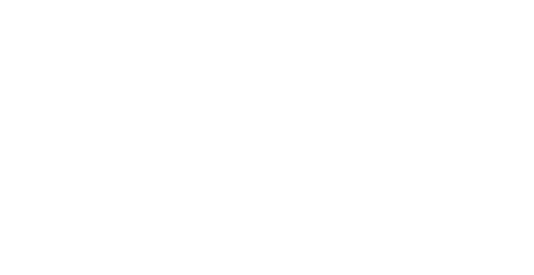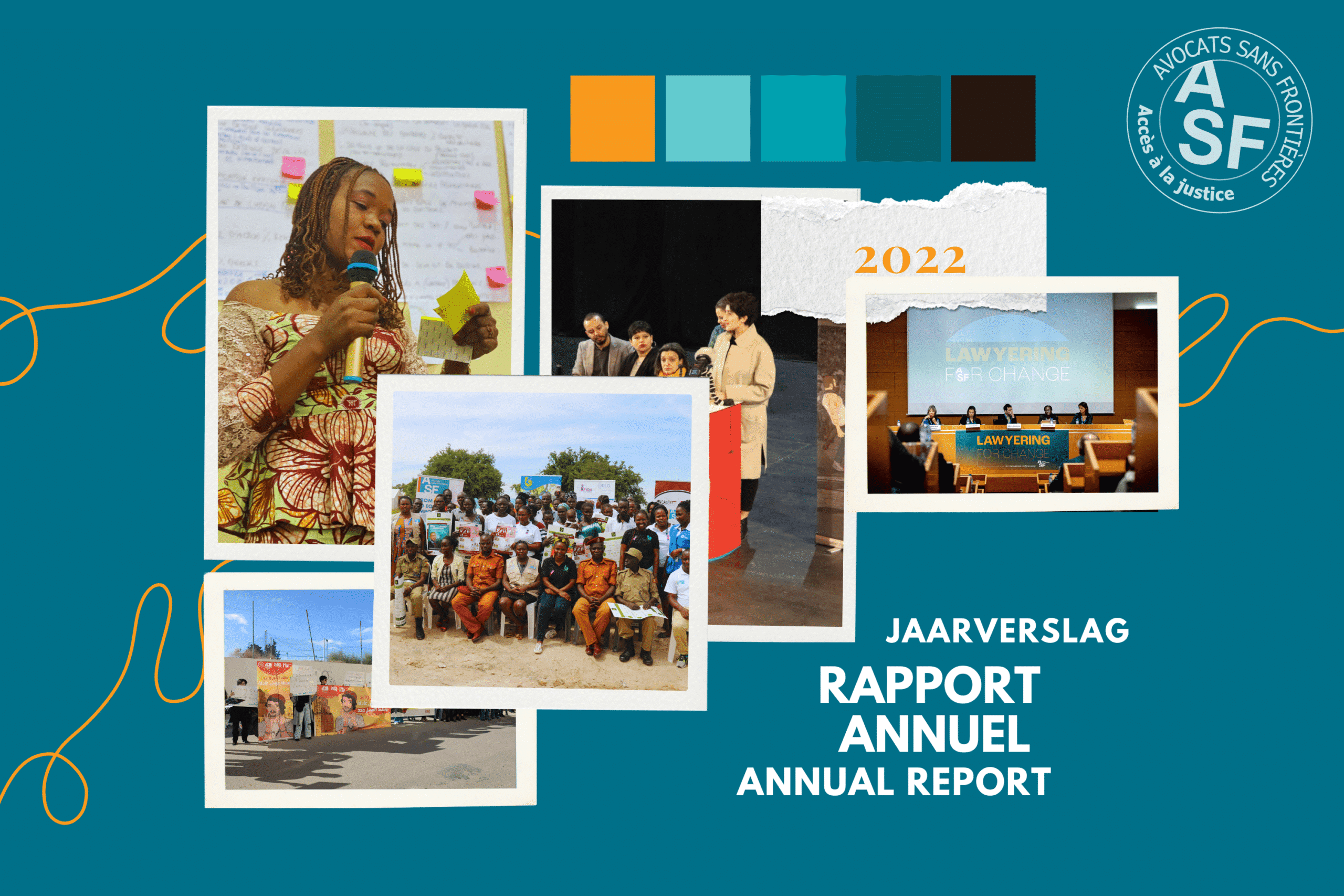Catégorie : Droits des enfants
-
Le rapport annuel d’ASF est disponible !
L’équipe d’Avocats Sans Frontières est ravie de pouvoir vous présenter son dernier rapport annuel, maintenant disponible sur notre site.
-
La pénalisation des pratiques de charlatanisme et de sorcellerie : Entrave à la réalisation des droits des femmes et des personnes mineures en République centrafricaine
En République centrafricaine (RCA), la pratique du charlatanisme et de la sorcellerie (PCS) est considérée comme une infraction par le code pénal. Les poursuites qui sont engagées à l’encontre des personnes suspectées de PCS conduisent fréquemment à des violations graves des droits humains et impactent, de façon systématique, les femmes et les enfants. À la…
-
L’acte de naissance en RCA: l’exception plutôt que la règle
La plupart des Centrafricains, surtout les plus jeunes, ne disposent pas d’un acte de naissance et n’existent donc pas aux yeux de l’Etat. A quoi cet déficit d’enregistrement est-il dû? Quels sont les obstacles à l’accès à l’état civil? Quelles en sont les conséquences? ASF a mandaté Thierry Vircoulon, spécialiste de l’Afrique centrale, pour réaliser…
-
ASF au Tchad: bilan et perspectives
Début mai, l’Union européenne a officiellement renouvelé son soutien aux activités d’Avocats Sans Frontières au Tchad, permettant ainsi à l’organisation d’y poursuivre son travail en faveur des droits humains. L’occasion de faire le point sur quelques résultats engrangés jusqu’à présent, et sur les défis à venir.
-
Sans identité, pas de droits
Sans déclaration de naissance, vous êtes privés d’un grand nombre de droits. Comment bénéficier d’un accès à des soins de santé sans document d’identité ? Comment se rendre à l’école ? Comment aller voter ? La plupart des Centrafricains, surtout les plus jeunes, n’existent pas aux yeux de l’Etat. En réponse à ce problème, Avocats…
-
Sans existence légale, pas de droits pour les citoyens congolais
Lubero, RD Congo – L’enregistrement à l’état civil des naissances, mais aussi des mariages, est une condition essentielle à la réalisation des droits des citoyens. C’est le message qu’ASF et ses partenaires ont partagé avec plus de 6.000 habitants du territoire de Lubero, dans le Nord Kivu.
-
Enfin la liberté pour une soixantaine de mineurs emprisonnés!
N’Djamena – Grâce à son projet mineurs, Avocats Sans frontières a pu obtenir la libération de 64 jeunes détenus dans la prison de N’Djamena, au Tchad. Le projet a également permis de mettre en évidence les difficultés que rencontrent enfants et adolescents dans le système judiciaire et les abus manifestes dont ils sont victimes.
-
Pour une meilleure aide à la jeunesse au Tchad
N’Djamena, Tchad. Avocats Sans Frontières (ASF), en partenariat avec l’ONG locale APLFT a lancé un projet visant à améliorer la prise en charge des mineurs d’âge à N’Djamena. Ce projet renforcera les capacités des différents acteurs de la chaîne sociale et judiciaire concernés par la problématique.