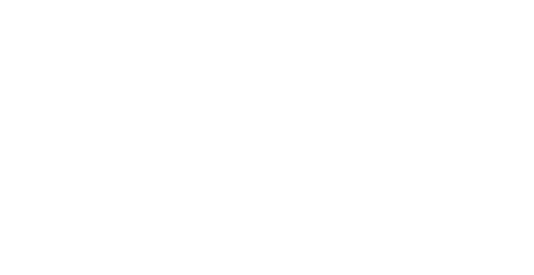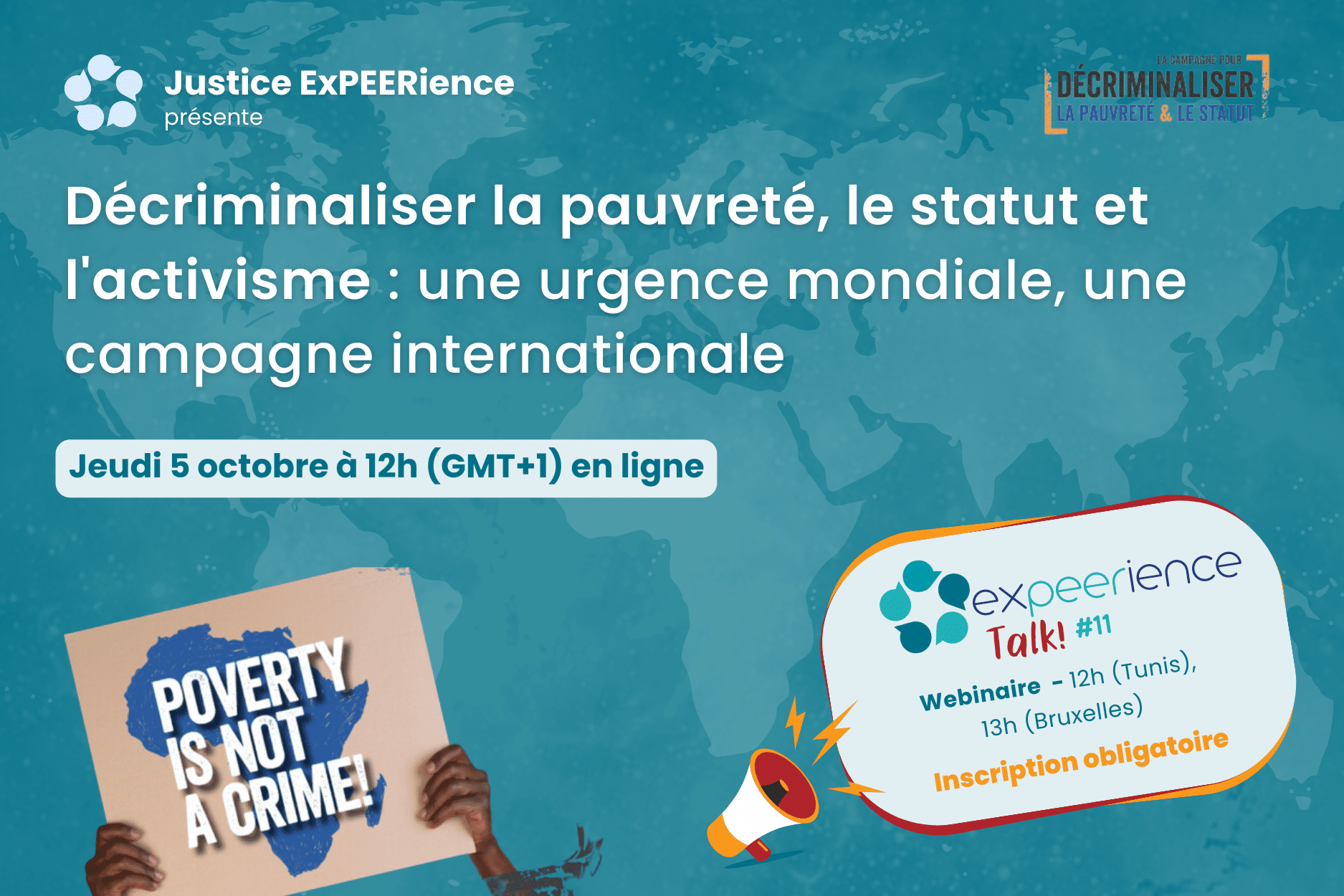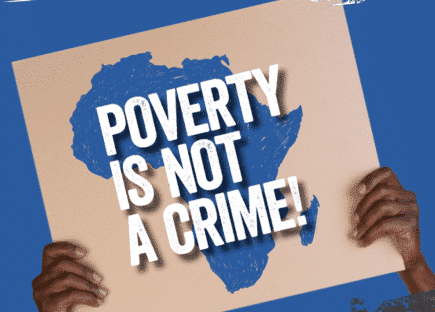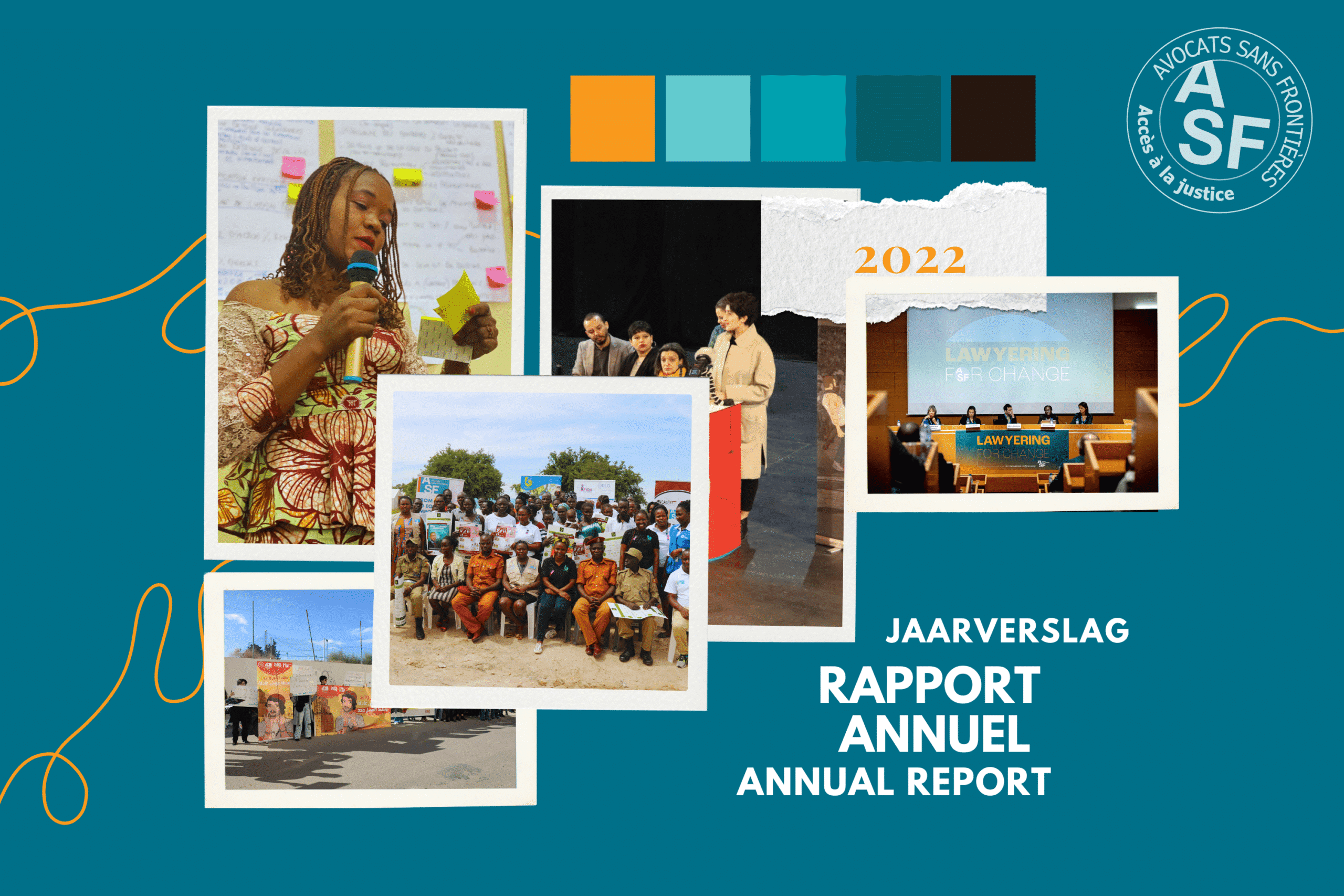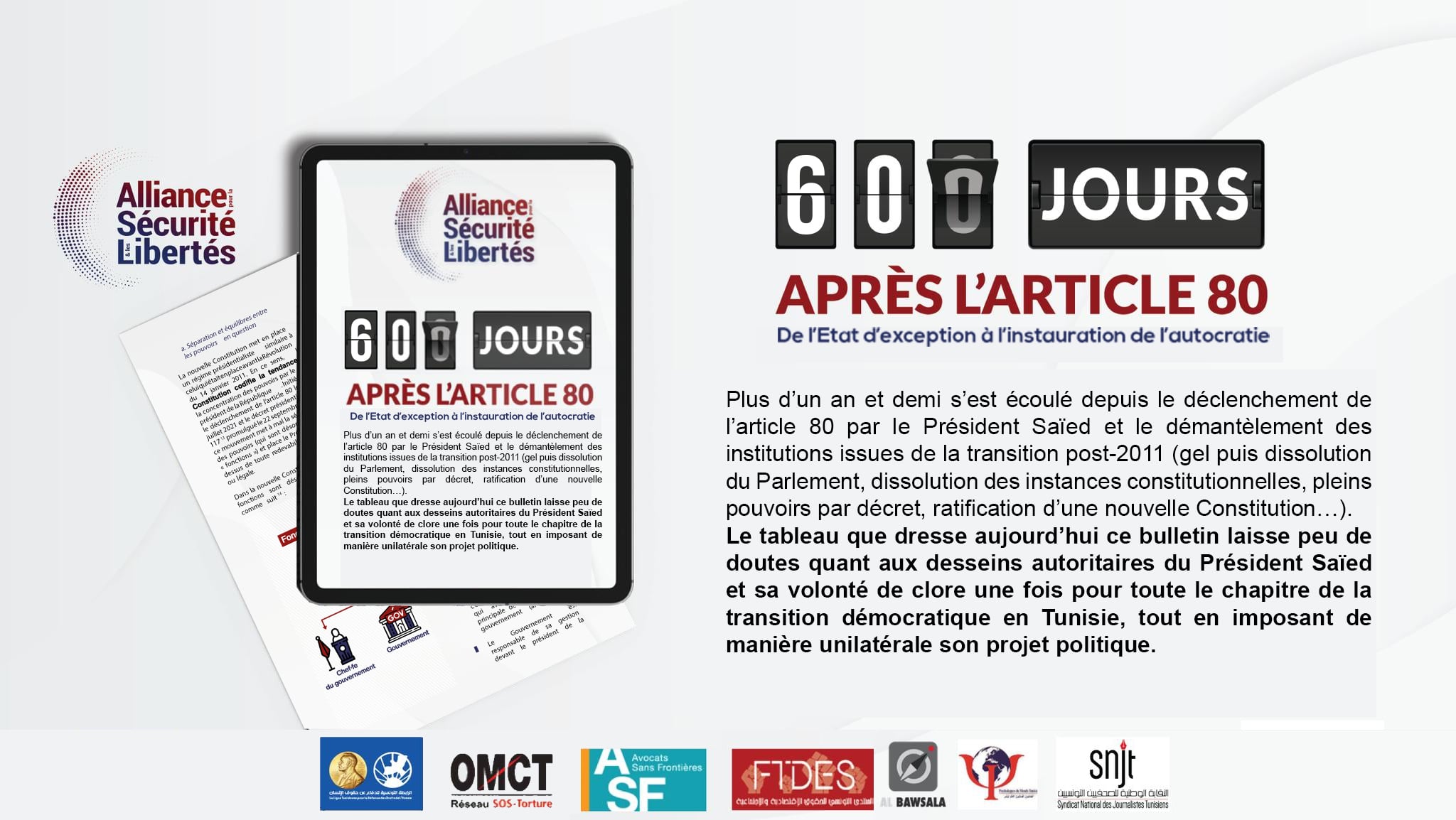Catégorie : Liberté d’expression
-
« Homeless, not guilty », un webinaire en ligne sur la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme
La Fondation Abbé Pierre, FEANTSA et Avocats Sans Frontières organisent un webinaire en ligne dans le cadre de la campagne mondiale pour décriminaliser la pauvreté, le statut et l’activisme.
-
L’espace civique en Tanzanie et en Ouganda : L’approche du contentieux stratégique
Depuis 2022, ASF met en œuvre un projet régional qui promeut l’utilisation des contentieux stratégiques comme outil pour apporter des réformes positives dans les domaines de l’espace civique et des libertés civiles en Ouganda et en Tanzanie. Des textes législatifs entravant la liberté d’expression ont été identifiés et contestés, grâce aux actions menées par ASF,…
-
Policy Brief – Analyse de l’état de l’Espace Civique en Afrique de l’Est sous le prisme judiciaire
Au cours des dernières années, l’espace civique a été décrit comme « rétrécissant » dans de nombreux pays à travers le monde. L’adoption de lois restrictives, le harcèlement de journalistes, l’arrestation et la détention de défenseur‧euse‧s des droits humains, la suspension des activités ou le gel des comptes des organisations de la société civile sont des tactiques…
-
Non à l’introduction de « l’atteinte méchante de l’autorité de l’État » dans le code pénal belge
ASF se joint à plus de 500 signataires issu‧e‧s du monde associatif, universitaire, judiciaire et de la société civile pour alerter sur la dangerosité de l’introduction dans le nouveau code pénal belge ce 22 février de l’infraction d’’atteinte à méchante à l’autorité de l’État’.
-
Afrique de l’Est – Protéger l’espace civique : une approche basée sur le contentieux stratégique
En 2022, le bureau régional Afrique de l’Est d’ASF a lancé un projet couvrant trois pays de la région : Burundi, Tanzanie et Ouganda. L’objectif du projet est de contribuer à la promotion de l’État de droit en encourageant les organisations de la société civile à recourir à des courts, des organes, des mécanismes et…
-
ExPEERience Talk #11 – Décriminaliser la pauvreté, le statut et l’activisme : une urgence mondiale, une campagne internationale
Ce 11ème ExPEERience Talk sera consacré à la Campagne pour la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme. Plusieurs de ses membres viendront y présenter son histoire, son fonctionnement, ses premières victoires et aborderont les défis rencontrés et les opportunités que présentent la mise en réseau d’une multiplicité d’acteur‧rice‧s pour s’attaquer à un…
-
La campagne pour la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme
ASF a rejoint la Campagne internationale pour la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme, portée par une coalition d’organisations de la société civile issues de nombreux pays. Cette campagne souhaite créer les conditions d’un changement global des lois, politique et pratiques pénales et social. Elle s’attaque à la criminalisation des délits mineurs…
-
Le bureau régional Euro-méditerranée
En 2018, ASF a pris la décision de créer un hub régional dans la région Euro-Méditerranée, basé à Tunis, dans le but de mutualiser les moyens et de renforcer et harmoniser son action dans la région. L’aspect novateur du bureau régional est d’assumer pleinement les liens historiques, économiques, politiques et culturels qui existent entre les…
-
Le rapport annuel d’ASF est disponible !
L’équipe d’Avocats Sans Frontières est ravie de pouvoir vous présenter son dernier rapport annuel, maintenant disponible sur notre site.
-
Tunisie – 600 jours après l’article 80 : De l’état d’exception à l’instauration de l’autocratie
L’Alliance Sécurité et Libertés (ASL), dont ASF est membre, publie son cinquième rapport sur l’État de droit et l’état des libertés en Tunisie. Amorcé au lendemain du coup de force du Président Saïed le 25 juillet 2021, le travail de monitoring et d’analyse quantitative et qualitative mené par ASL revient dans cette cinquième édition sur…