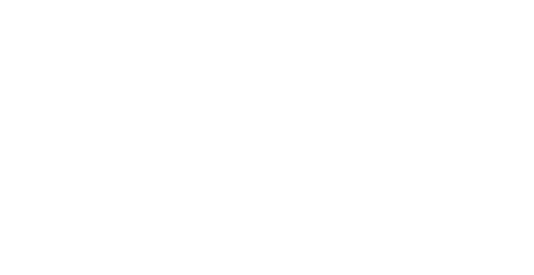Catégorie : Business & human rights
-

Renforcer les capacités de la société civile et des parajuristes en Tanzanie afin d’améliorer l’accès aux voies de recours dans le secteur extractif
Dans le cadre de son programme régional sur les entreprises, les droits humains et l’accès à la justice en Afrique de l’Est, Avocats Sans Frontières (ASF) renforce les capacités des acteurs de la société civile à défendre les communautés touchées par les industries extractives. En Tanzanie, ASF travaille en partenariat avec Business and Human Rights…
-
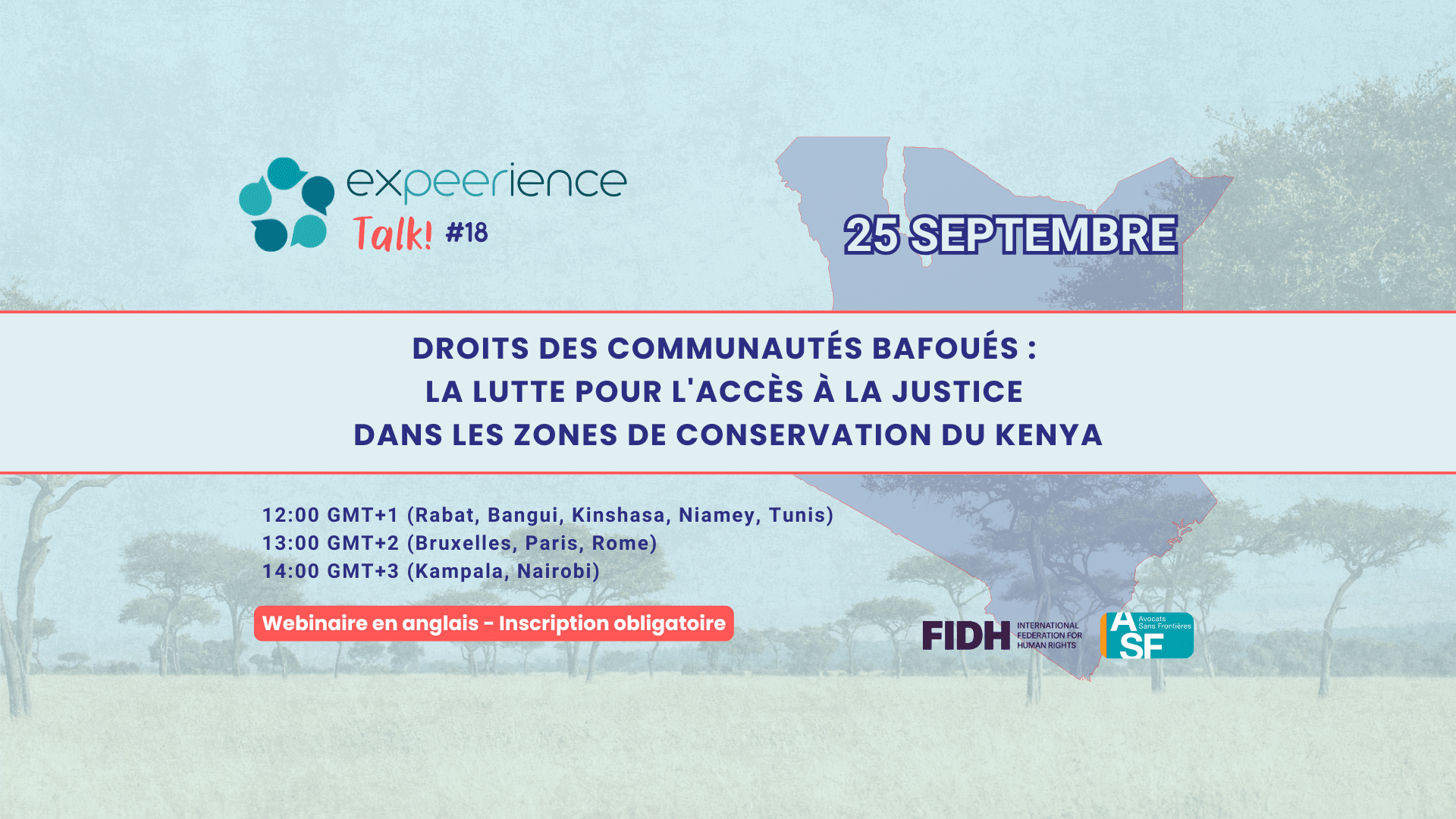
ExPEERience Talk 18 – Droits des communautés bafoués : la lutte pour l’accès à la justice dans les zones de conservation du Kenya
Justice ExPEERience vous invite à son prochain ExPEERience Talk, animé par ASF et auquel participeront deux expert·e·s et un·e représentant·e de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Ce webinaire présentera les conclusions du rapport “Access to Remedy for Communities Affected by Conservancies in Isiolo”. Cette étude, menée dans le nord du Kenya, offre…
-

Accès à la justice : les droits des communautés bafoués dans les zones de conservation du Kenya
Avocats Sans Frontières (ASF) et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) publient un nouveau rapport qui met en lumière des violations graves et persistantes des droits humains dans les zones de conservation dans le comté d’Isiolo, au nord du Kenya. Le constat est alarmant : alors que les initiatives de conservation se multiplient,…
-
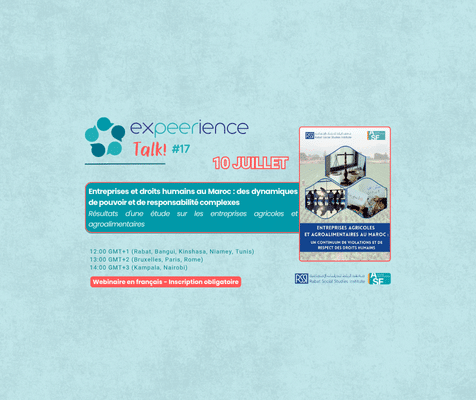
ExPEERience Talk #17 – Entreprises et droits humains au Maroc : des dynamiques de pouvoir et de responsabilité complexes
Avocats Sans Frontières (ASF) et le Rabat Social Studies Institute (RSSI) vous invitent à un webinaire consacré à la présentation des résultats du rapport « Entreprises agricoles et agroalimentaires au Maroc : un continuum de violations et de respect des droits humains « , fruit d’une enquête approfondie menée au sein des Petites et Moyennes Entreprises (PME) des secteurs agricoles…
-

Journée mondiale de l’environnement : Le droit à un environnement sain
Jouir d’un environnement sain, sûr, propre et durable est un droit fondamental. Le défendre est l’un des combats déterminants de notre époque. Chez ASF, nous défendons le droit à un environnement sain à travers l’aide juridique, le plaidoyer stratégique et l’engagement communautaire.
-

Union européenne : La grande dérégulation – La proposition Omnibus revient sur les engagements de l’UE en matière de responsabilité des entreprises et porte une grave atteinte à la protection des droits humains et de l’environnement
La publication par la Commission européenne de sa proposition Omnibus révisant les principales lois sur le développement durable des entreprises envoie un signal politique clair : la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a renoncé aux droits humains, aux droits des travailleur·euse·s et à la protection de l’environnement au profit d’une dangereuse déréglementation.…
-
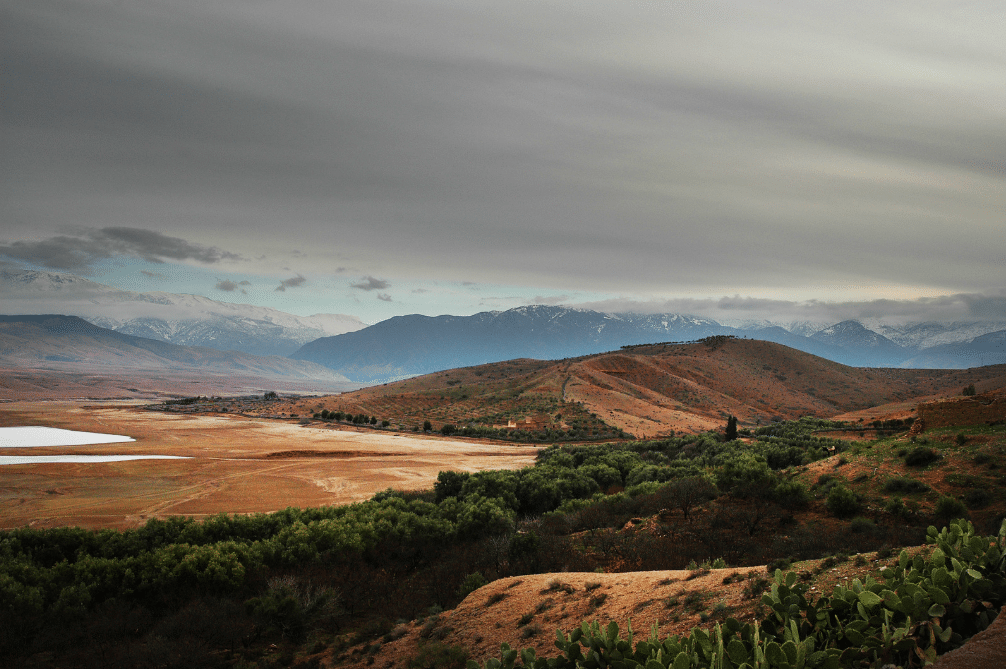
Entreprises agricoles et agroalimentaires au Maroc : Un continuum de violations et de respect des droits humains
Avocats Sans Frontières (ASF) et le Rabat Social Studies Institute (RSSI) présentent une étude approfondie sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains (REDH) au Maroc, avec un focus sur les pratiques des Petites et Moyennes Entreprises (PME) des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette analyse dévoile les dynamiques complexes de pouvoir et de…
-
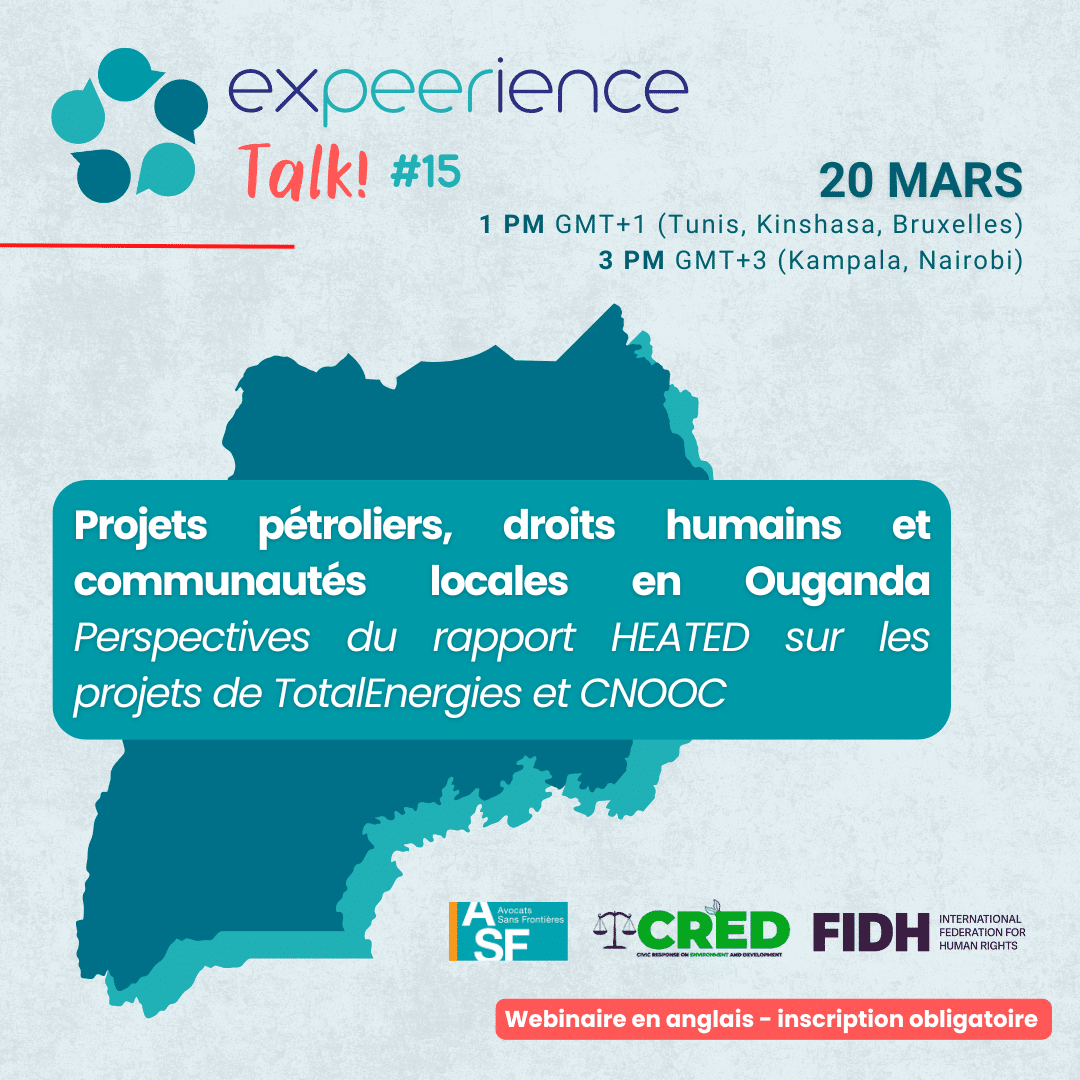
ExPEERience Talk #15 : Projets pétroliers, droits humains et communautés locales en Ouganda –– Perspectives du rapport HEATED sur les projets TotalEnergies et CNOOC
Alors que développement des projets pétroliers en Ouganda entre dans une nouvelle phase critique, les violations des droits humains s’intensifient. Le rapport HEATED : Human Rights, Frontline Communities, and Oil in Uganda met en lumière des abus graves affectant les communautés locales, notamment ne lien avec des projets menés par des géants de l’industrie tels…
-
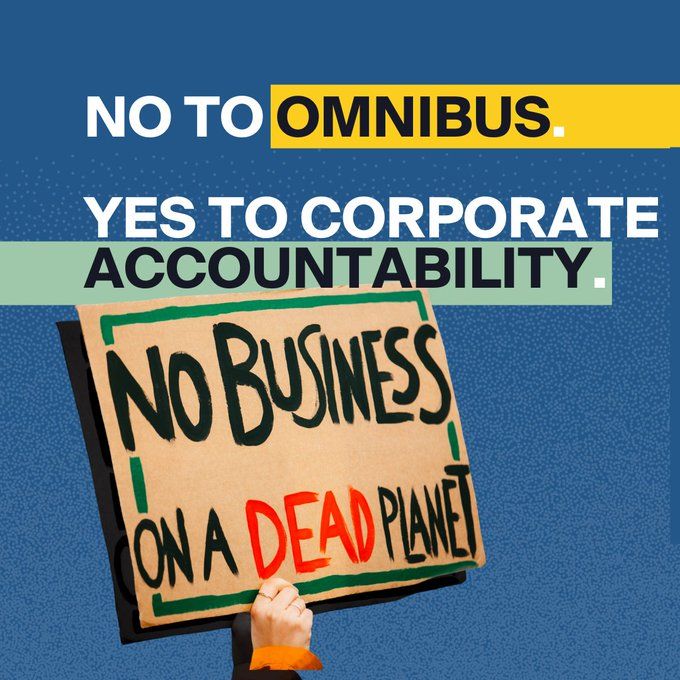
La proposition Omnibus de l’UE génère une confusion coûteuse et nuit à la protection des personnes et de la planète
ASF se joint à plus de 160 organisations de la société civile, défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, candidats et activistes pour dire non à la proposition Omnibus de l’UE ! Le 8 novembre 2024, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu’elle présenterait une proposition visant à…
-

Projets pétroliers en Ouganda : graves atteintes aux droits humains et menaces croissantes alors qu’une nouvelle phase de développement s’ouvre
ASF publie en collaboration avec la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) et le Civic Response on Environment and Development (CRED) un rapport sur les violations des droits humains des populations dues aux activités des grandes entreprises pétrolières en Ouganda et la répression étatique des défenseur·euse·s des droits humains.