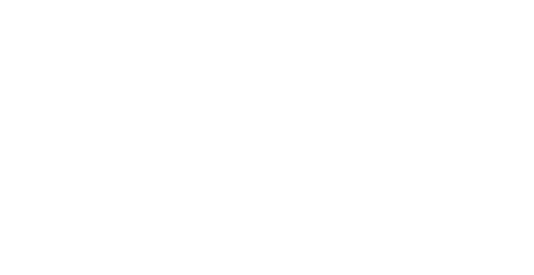Pays : Belgique
-

ASF publie son rapport annuel 2024 : défendre les droits humains dans un monde en repli
Avocats Sans Frontières (ASF) publie aujourd’hui son rapport annuel 2024, celui-ci rend hommage à celles et ceux qui, partout dans le monde, mettent leur liberté – et parfois leur vie – en jeu pour défendre les droits fondamentaux.
-

-

ASF fait évoluer sa gouvernance pour une meilleure représentativité des engagements et de la diversité de l’organisation
ASF est une organisation en constante évolution. Face à la diversité croissante de ses équipes, de ses partenaires, de ses actions et des contextes dans lesquels elle intervient, ASF se doit de s’adapter pour que son fonctionnement et ses organes de gouvernance restent en phase avec ce qu’elle devient et aspire à devenir. En 2024,…
-

La criminalisation du sans-chez-soirisme en Belgique, une approche punitive et inefficace
Le sans-chez-soirisme est un problème de plus en plus visible en Belgique, malgré les discours politiques promettant des solutions. Au lieu de bénéficier d’une approche de soutien, les personnes sans-chez-soi sont souvent confrontées à des mesures répressives qui aggravent leur précarité. Dans un Policy Brief publié le 07 avril, ASF met en lumière cette dynamique…
-
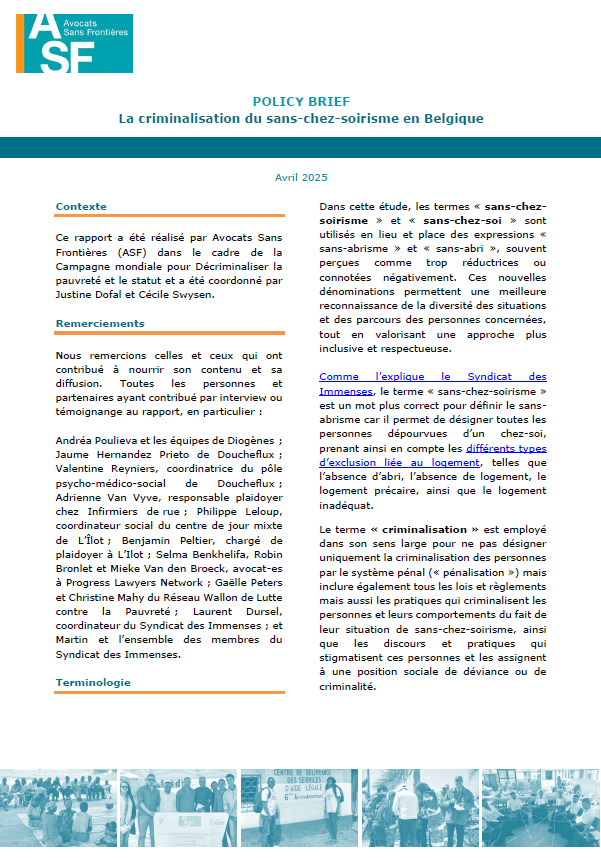
-

Sans-abri non coupable : Lutter contre la criminalisation et la stigmatisation des personnes sans-abri
Dans un rapport conjoint, Avocats Sans Frontières, FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre appellent à mettre fin aux sanctions imposées aux sans-abri et à la stigmatisation dont il·elle·s sont l’objet en Europe.
-
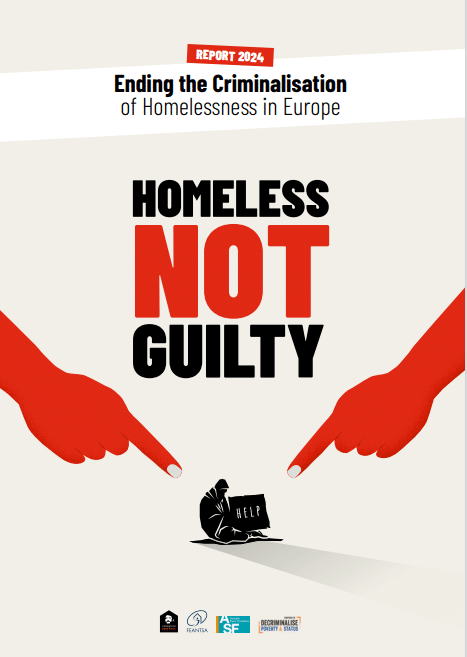
Sans-abri non coupable – Mettre fin à la criminalisation du sans-abrisme en Europe (Anglais)
Aussi disponible en français
-
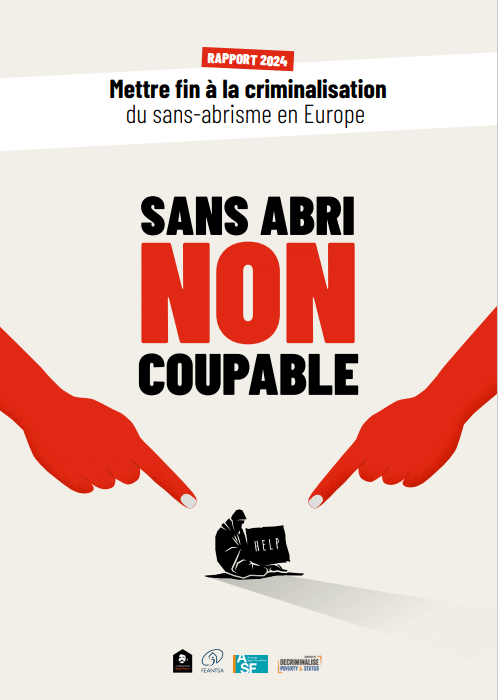
Sans-abri non coupable – Mettre fin à la criminalisation du sans-abrisme en Europe (Français)
Aussi disponible en anglais
-

« Homeless, not guilty », un webinaire en ligne sur la décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l’activisme
La Fondation Abbé Pierre, FEANTSA et Avocats Sans Frontières organisent un webinaire en ligne dans le cadre de la campagne mondiale pour décriminaliser la pauvreté, le statut et l’activisme.
-
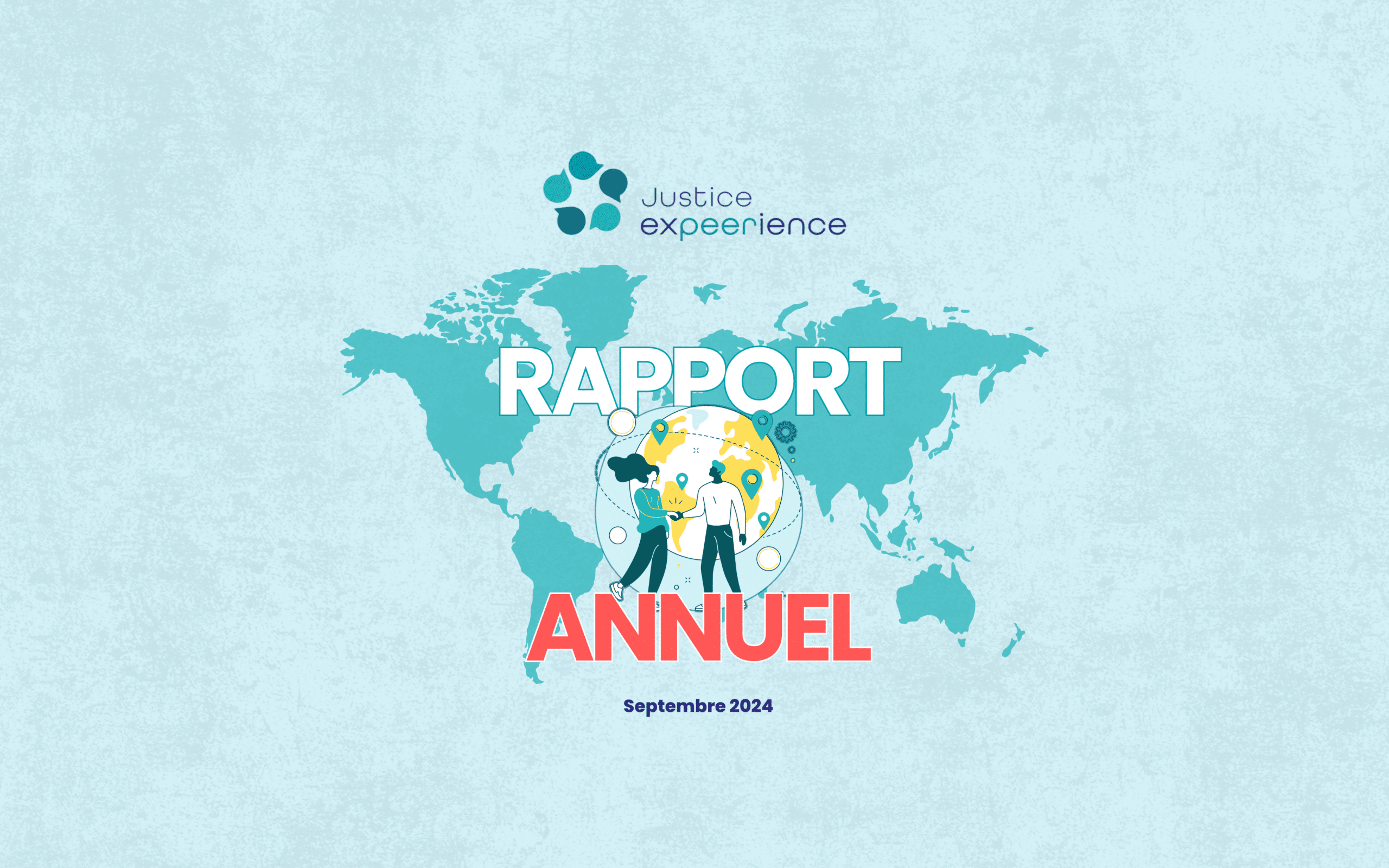
Le réseau Justice ExPEERience continue de grandir : bilan et nouveautés
Justice ExPEERience a fêté cet été ses 3 ans d’existence ! À cette occasion, l’équipe de coordination du réseau est fière de vous présenter le rapport annuel de Justice ExPEERience.