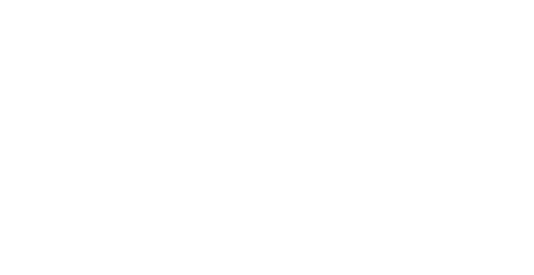Pays : Népal
-
La justice internationale dans tous ses états (2/4) : le Népal
Durant ces mois d’été, ASF, dans le cadre du projet Intersections, vous informe des dernières actualités en matière de justice internationale. Cette semaine, Prashannata Wasti, qui travaille pour notre partenaire INSEC, partage les dernières nouvelles en provenance du Népal. Découvrez de quelle manière le terrible tremblement de terre d’avril dernier interfère dans l’accès à la…
-
Les Népalaises en quête de leurs droits
Quand un Népalais abandonne sa famille, il est courant que sa femme soit réduite à l’indigence. Les Népalaises se voient systématiquement dénier leurs droits, tout spécialement la propriété, l’héritage et la pension alimentaire. En association avec des barreaux locaux, ASF joue un rôle crucial dans la sensibilisation des femmes à la loi et dans leur…
-
Radio Justice
Katmandou – Comment assurer que les citoyens connaissent leurs droits, quand une grande partie de la population est illettrée, pauvre et vit dans des régions rurales reculées ? Au Népal, la radio communautaire est le moyen idéal pour sensibiliser et informer les habitants. ASF y diffuse des jingles et des émissions-débats. L’occasion de recueillir des…
-
Des avocates népalaises améliorent leurs connaissances en techniques médico-légales
Pour les tribunaux traitant d’affaires criminelles, les éléments médico-légaux sont des preuves de première main. Une formation organisée par ASF soutient les avocates dans leur pratique en ce qui concerne ces éléments, en particulier dans les cas de violation des droits des femmes.
-
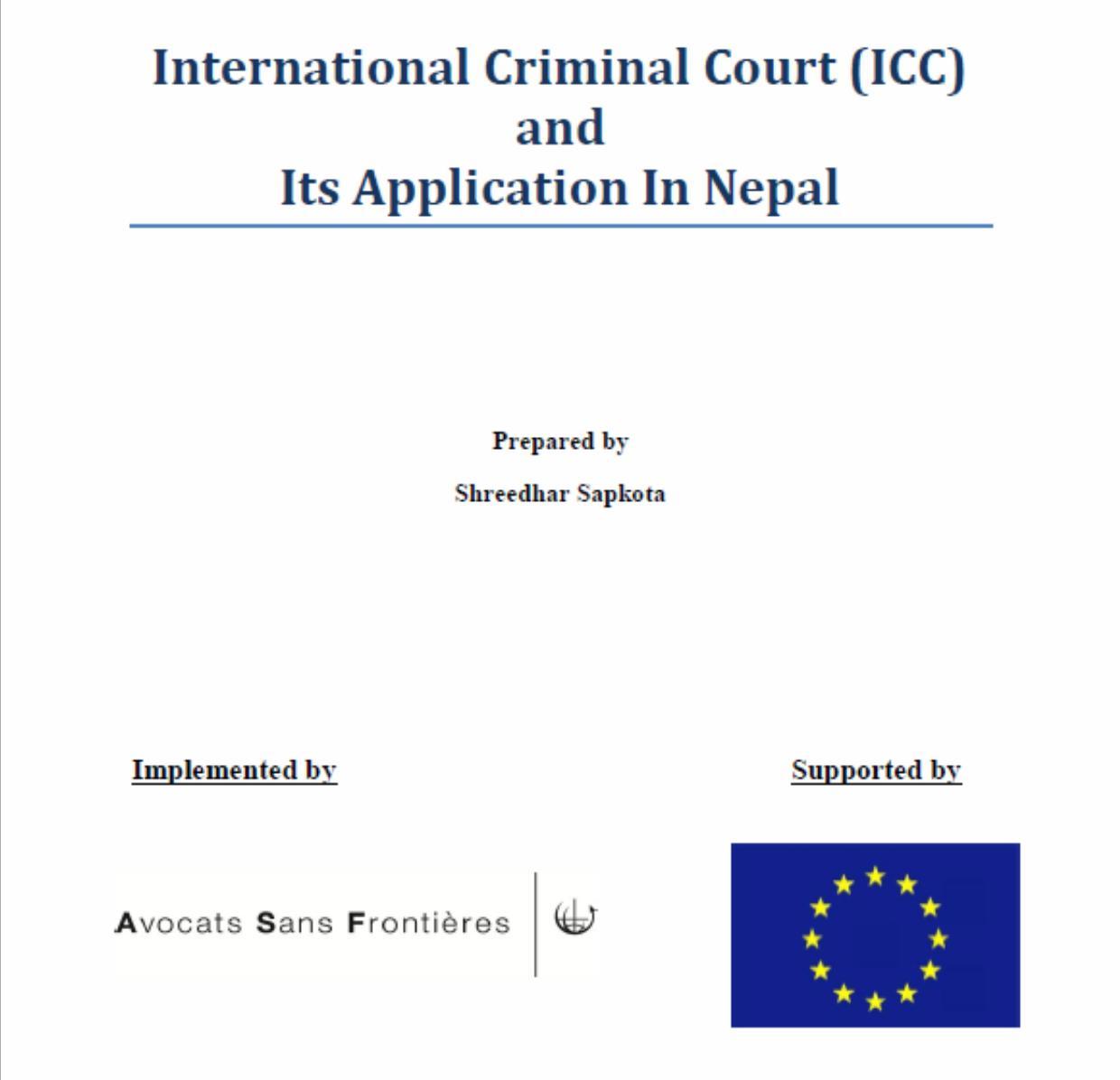
-
Les avocats népalais se mobilisent contre la traite des êtres humains
Améliorer l’accès à la justice est crucial pour lutter contre l’impunité du trafic d’êtres humains au Népal. En collaboration avec le barreau du district et avec une ONG partenaire, ASF organise des boutiques de droit itinérantes pour pallier à ce phénomène répandu. Grâce à ces centres de consultations juridiques itinérants, les communautés sont sensibilisées à…
-
Lutte contre la torture: Attention aux «fausses victoires»
Bruxelles/Bukavu/Kathmandou, 26 juin 2012 – A l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre la Torture, ce 26 juin, Avocats Sans Frontières (ASF) rappelle la nécessité de lutter contre l’impunité des tortionnaires.
-
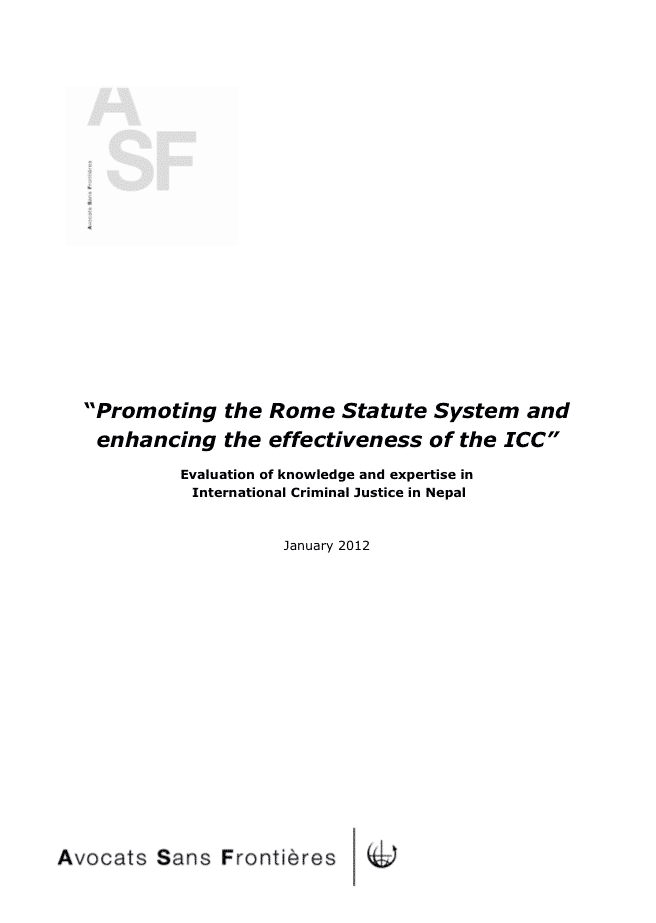
-
Tous les moyens sont bons pour informer la population de ses droits
Ce matin, l’extrême Ouest du Népal connaît un froid glacial. Gopi Parajuli (ASF) et Anita Neupane (Legal Aid and Consultancy Centre) se frayent un chemin indécis sur le parking des bus. Comme souvent au Népal, un passant leur vient spontanément en aide : « Vous cherchez le bus des avocats ? Le voici ! »