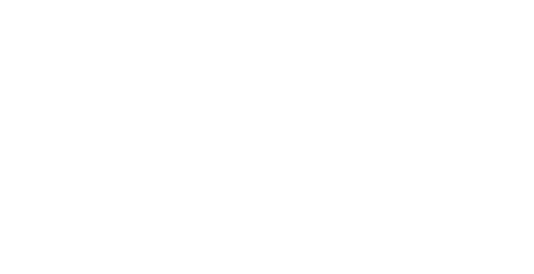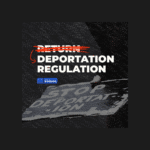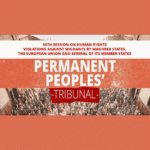Sinds 2004 ondersteunt ASF de vervolging van internationale misdaden in de Democratische Republiek Congo. We documenteren internationale misdaden en bieden juridische en gerechtelijke ondersteuning aan slachtoffers zowel voor, tijdens als na het proces. Dat gebeurt steeds in overleg en nauwe samenwerking met de Congolese autoriteiten, VN-agentschappen en internationale partners.
In 2023 begeleidde ASF slachtoffers van ernstige misdaden in verschillende processen, met name in de zaken “Kavira”, “Kolonel Arama et al”, “Cobra Matata” en “Ezekere”. In totaal hebben 814 slachtoffers gratis juridische bijstand gekregen in deze vier zaken over internationale misdaden die in de provincie Ituri, in het oosten van de DRC, werden gepleegd door gewapende groepen (ADF1 en FRPI2) en door leden van de FARDC3. De meeste beklaagden kregen zware straffen voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals moord, verkrachting, plundering, vernieling, brandstichting en het ronselen en inzetten van kindsoldaten.
In het Kavira-arrest van 29 november 2023 werd bepaald dat de slachtoffers van alle gerechtskosten worden vrijgesteld. Dat was de eerste keer dat de nieuwe wet van 22 december 2022 inzake de algemene beginselen voor de bescherming en schadeloosstelling van slachtoffers werd toegepast in Ituri.
Een nieuwe holistische benadering van overgangsjustitie
Voor ASF en haar partners was dit eveneens de aanleiding om in 2023 nieuwe richtlijnen te definiëren en een holistische benadering van overgangsjustitie te hanteren waarbij het gebruik van gerechtelijke en buitengerechtelijke, formele en gemeenschapsgebonden mechanismen gecombineerd worden.
Deze benadering plaatst de gemeenschappen en de slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen centraal in het proces van overgangsjustitie. De mechanismen van overgangsjustitie worden aangepast aan de context om rekening gte houden met de specifieke provinciale omstandigheden en zo recht te doen aan de behoeften en verwachtingen die de slachtoffers uiten.
De nieuwe strategie voor overgangsjustitie van ASF en haar partners richt zich op capaciteitsopbouw en empowerment van gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld, technische ondersteuning en hulp bij de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende actoren betrokken bij de overgangsjustitie.
Deze nieuwe richtlijnen zullen in 2024 worden geconcretiseerd met de lancering van twee nieuwe driejarige projecten met betrekking tot justitie, gefinancierd door de Europese Unie (“Holistische en inclusieve overgangsjustitie om de strijd tegen straffeloosheid in de DRC te consolideren en te versterken”, in samenwerking met TRIAL) en door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in de DRC (“Eigenaarschap en leiderschap van de gemeenschap voor de hervorming van overgangsjustitie in Ituri en Noord-Kivu”, in samenwerking met Impunity Watch).